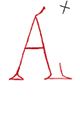Qu’un festival ne soit plus populaire, qu’il ne me permette plus de m’inscrire dans un mouvement, est inquiétant. Sur toute la durée de cette 66ème édition, j’ai vu 38 spectacles pour un coût total de 1850 € (830€ de places et 1020€ de location d’appartement). Seulement neuf d’entre elles m’ont éclairé, enthousiasmé, tourmenté. Respecté, j’ai eu envie d’écrire. Passionnément. Neuf, soit moitié moins que les années précédentes. Neuf soit vingt-neuf propositions où j’ai, au mieux erré, au pire sombré dans le néant.
Cette proportion est inquiétante et signe une crise de sens, de valeurs, de propos. Trop rares ont été les moments où j’ai pu penser, faire mon chemin. Me revient alors le jugement éclairé d’un spectateur, posté sur sa page Facebook: «Cette année le public est absent d’Avignon. Vous ne comprenez pas la différence entre tenir compte du gout du public et simplement tenir compte de sa présence…».

Notre présence.
Le public était présent. J’étais là pour «La Mouette» mise en scène par Arthur Nauzyciel. Rarement, je n’ai vu une telle humanité en jeu dans cette cour qui écrase tout. Ici, l’art a repris ses droits et les artistes ont dansé pour caresser les murs et calmer cet espace autoritaire. Ils ont accueilli mes fragilités pour me restituer une vision sur la place de l’art dans une société en crise. J’en suis sorti plus fort, plus habité. Mouette.
Sophie Calle n’est pas une artiste de théâtre. Elle expose. Et pourtant, elle a créé la scène autour de sa mère, décédée en 2006, jusqu’à lire quotidiennement son journal intime. «Rachel, Monique» était à l’Église des Célestins .Tel un rendez-vous avec une chanson de Barbara, nous y sommes revenus plusieurs fois comme un besoin vital de ressentir une nostalgie créative. Le 28 juillet à 17h, nous étions présents alors qu’elle lisait les dernières pages. Sophie Calle a créé le rituel pour nous rassembler, celui qui nous a tant manqué pendant le festival.
Le chorégraphe Olivier Dubois est arrivé le 25 juillet et a provoqué le séisme que nous attendions. Avec «Tragédie», nous étions spectateurs et acteurs de notre humanité en mouvement. Nous avons ovationné ces dix-huit danseurs. Pas un seul n’a échappé à mon empathie. Processus identique avec Jérôme Bel où dans «Disabled Theater» des acteurs handicapés mentaux ont réduit la distance pour que la danse fasse lien au-delà des codes usés de la représentation. Avec «33 tours et quelques secondes», Lina Saneh et Rabih Mroué ont tenté de renouveler ces codes à partir d’un dispositif sans comédien. Sans ma présence, cette pièce ne pouvait exister. J’étais là parce que l’absence a donné une âme au théâtre .
En nous convoquant sous la scène du Palais des Papes, le performeur sud-africain Steven Cohen nous a plongés au sens propre dans les bas fonds de l’humanité pour y vivre l’horreur de l’extermination des juifs. On ne s’en sortira jamais. Un regret: peu de spectateurs ont vu cette performance (jauge d’à peine 50 places) et n’auront fait connaissance avec cet artiste hors du commun qu’avec «Le Berceau de l’humanité», oeuvre bien moins aboutie.
Avec «Conte d’amour», le suédois Markus Öhrn nous a lui aussi donné rendez-vous au sous-sol pour y vivre, par caméra interposée, l’effroi de l’amour incestueux. Rarement je n’ai senti un public aussi présent face à une bâche de plastique qui nous séparait des acteurs. Même présence pour «Disgrâce», mise en scène par Kornel Mundruczo qui m’a donné envie de lire cet été, le roman de J.M Coetzee. Du théâtre vers l’écrit pour lire autrement.
Au cours de ce festival, j’ai parfois ressenti l’effondrement de notre civilisation. Seul Roméo Castellucci pouvait s’emparer de ce trou noir qui pourrait nous sauver. «The Four Seasons Restaurant» n’était qu’une initiation. Un autre monde est à venir.
Le goût du public.
Festival d’Avignon, festival de création ? Pas si sûr…Comme tant de théâtres en saison, il s’est moulé dans le consensus mou qui ne fait émerger aucune idée, à peine incarnée par des acteurs. Les logiques de coproduction priment sur des prises de risque assumées comme si la responsabilité des deux programmateurs d’Avignon se diluait dans des contrats à multiples feuillets.
Il y avait d’ailleurs une certaine indécence à nous proposer «Les contrats du commerçant. Une comédie économique» de Nicolas Stemann à 36 euros la place, prix à payer pour subir un délire de clichés rabâchés sur la crise financière et la possibilité de quitter le spectacle pour la buvette installée pour l’occasion. Le public aisé (présent ou absent, là n’était plus la question !) a beaucoup aimé. Moi pas. .
Autre propos démagogue. Celui de Thomas Ostermeier (artiste associé du festival en 2004) qui m’avait habitué à plus de rigueur. Son théâtre participatif autour d’ «Un ennemi du peuple» d’Henrik Ibsen n’était qu’une énième reproduction d’un système de pensée que l’on répète à l’infini. Ce théâtre bourgeois sans vision va à coup sûr plaire aux programmateurs qui trouveront là, à moindres frais, de quoi faire de leur établissement un lieu de citoyenneté! Est-ce du niveau du Festival d’Avignon ?
Le public aime Christoph Marthaler (artiste associé du festival en 2008). Était-ce bien judicieux de nous proposer «My Fair Lady, un laboratoire de langues», spectacle certes très drôle, mais si vain. Le public aime Joseph Nadj (artiste associé du festival en 2006). Certes. Mais «Atem le souffle» était une oeuvre venue d’en haut vers le bas. Si Avignon est une chapelle, je n’ai pas choisi d’être pénitent ou pèlerin.
Additionnées, ces propositions ont provoqué une censure sourde qui n’autorise presque plus aucune élévation de la pensée. La danse a nourri ce processus jusqu’à servir d’appât, elle qui stimulait il y a seulement quelques années, des débats sans fin. Romeu Runa produit par les Ballets C de La B (fournisseur officiel annuel du Festival. Je fais le pari qu’ils seront programmés en 2013), Sidi Larbi Cherkaoui, et Régine Chopinot. n’ont été que des «produits» d’appel: une danse du vide pour un trop-plein de clichés et de déjà vu. J’ai regretté l’échec de la proposition de Nacera Belaza: «Le trait» n’était finalement qu’une courbe s’épuisant sur elle-même. Tout comme ais-je été déçu par le peu d’énergie dans «C’est l’oeil que tu protèges qui sera perforé» de Christian Rizzo: le mouvement était au service d’une «installation» où l’on est passé trop vite d’un «ici» à un «là».
À mes remarques, une affirmation est revenue, comme seule réponse: «oui, mais il y avait de belles images». En tant qu’artiste associé, Simon McBurney nous a imposé sa critique du théâtre: peut-il aujourd’hui transcender sans l’image? Dans «Le maitre et Marguerite» à la Cour d’Honneur, il nous infligé un surtitrage aberrant, permettant au théâtre d’abdiquer face au poids de l’image. Le public a aimé. Et alors ?
Notre dignité, notre potentiel, notre rôle.
Dans un article publié dans Libération en mars dernier, le philosophe Bernard Stiegler et l’acteur Robin Renucci écrivaient: «Jean Vilar a inventé une place pour le spectateur en affirmant sa dignité, son potentiel et son rôle. Réinventons dans notre contexte la relation entre l’art et la société dans un souci d’élévation permanente». Tout au long du festival, cette relation a souffert. L’artiste associé, Simon McBurney, y a largement participé: il nous a imposé son réseau qui nous a négligés. La palme revient à Katie Mitchell qui a démissionné avec une oeuvre radiophonique («Les anneaux de saturne») et une conférence sur le réchauffement climatique («Ten billion»)! Mais de quel théâtre de création s’agit-il? Avec «La négation du temps», William Kentridge a recyclé sur scène son installation actuellement exposée à la Documenta de Kassel. Mais quel ennui ! Avec «L’orage à venir», le collectif Forced Entertainment m’a bien fait marré la première heure, mais à la seconde, j’ai décroché: s’interroger sur la narration au théâtre aurait pu les amener quelque part sauf qu’ils n’ont cessé de recommencer. Mais pour qui nous prend-on? La palme de l’oeuvre indigne revient probablement à Katya et John Berger pour «Est-ce que tu dors?». Cette proposition de médiation culturelle au musée était obscène. Le père et la fille ne se rendant pas compte que leur dissertation d’un niveau terminale sur l’oeuvre d’Andréa Mantegna («la chambre d’amour») ne visait finalement qu’à se coucher dans le même lit. Personne n’a quitté la Chapelle des Pénitents Blancs pour autant à la différence de “Conte d’amour“!
Les Français Sandrine Buring et Stéphane Olry n’ont pas été en reste. Avec «Ch(ose) / Hic Sunt Leones», ils ont osé nous faire dormir sur des transats pour mieux nous enfumer sur leur incapacité à finir une oeuvre dans les temps. Pourquoi les avoir programmés ?
Les enfants? Ils n’existent toujours pas dans ce festival. C’est un non-public, jusqu’à leur infliger «Les animaux et les enfants envahissent la rue» de Suzanne Andrade et Paul Barritt. Trois comédiens se baladent dans une bande dessinée projetée en vidéo avec pour seul horizon, l’histoire d’un quartier où les gamins sont voués à ne jamais sortir de leur misère. C’était un spectacle à la pauvreté scénique déconcertante, bête et dépressif.
Notre absence.
Le théâtre français a incarné un «système» sans vision qui s’enferme dans un entre soi parisien terrifiant. Ce que j’ai vu à Avignon fut profondément mortifère, ancré dans un théâtre où la forme, les effets visuels prenaient le pas sur tout le reste. À chaque représentation, je me suis ressenti déconnecté, pas là. Consommateur, mais jamais sujet.
Éric Vigner pour«La faculté», Stéphane Braunschweig pour«Six personnages en quête d’auteur», Guillaume Vincent pour «La nuit tombe» et Séverine Chavrier pour «Plage ultime» ont pollués ce festival avec leur théâtre insignifiant.
À côté Bruno Meyssat avec «15%» et Jean-François Matignon avec «W/GB84» avaient un propos pour le Festival : sauf qu’ils nous ont perdus en route. L’un par excès poétique, l’autre par excès d’ambition.
Le 28 juillet, je décidais de me rendre aux dernières heures de la performance de Sophie Calle pour revoir ensuite «Tragédie» d‘Olivier Dubois et assister de nouveau au deuxième acte avec les acteurs de «La mouette» d’Arthur Nauzyciel.
Le 28 juillet fut mon festival. Comme une réponse aux programmateurs qui sont devenus, comme tant d’autres, des techniciens du spectacle.
Sans projet.
Pascal Bély – Le Tadorne.