

Cette année, ces « Rencontres à l’échelle » dégagent l’horizon pendant que le sol craquelle. A suivre jusqu’au 25 octobre à Marseille.
Pascal Bély
www.festivalier.net
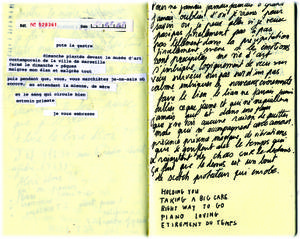




Pascal Bély. www.festivalier.net
“Je tremble” (1) et (2) de Joël Pommerat a été joué le 24 juillet 2008 au Festival d’Avignon.



"La mélancolie des dragons" de Philippe Quesne a été joué le 20juillet 2008 dans le cadre du Festival d'Avignon.






Pascal Bély
www.festivalier.net
Seul sur la scène de ce petit théâtre au coeur de la Friche Belle de Mai à Marseille, cheveux gominés, costume impeccable, il nous regarde sans sourciller. Il est légionnaire et son double se projette en direct dans une télévision décorée de ses apparats. Des micros sont tendus comme autant de perches pour entendre de sa bouche les mots de l’écrivaine Sonia Chiambretto. En entrant, je suis saisi par la beauté et la modernité du décor, proche de l’univers du metteur en scène allemand, Thomas Ostermeier. La scénographie audacieuse d’Hubert Colas met en relief le propos alors que le corps de l’acteur donne au texte des airs de musique militaire sur une partition d’opéra.
Manuel Vallade est exceptionnel. Son corps transpire à certains moments comme autant d’émotions refrénées qui s’immiscent dans le texte. Il fait corps, à corps défendant, avec cet esprit de corps. Sa beauté nous renvoie au film “Beau travail” de Claire Denis qui avait su nous restituer l’atmosphère de la légion à partir d’une chorégraphie endurante et sensuelle. En quarante minutes, se crée une alchimie faite de pureté, d’un engagement sans limites et d’une souffrance contenue. Je ne le quitte pas des yeux de peur que cet humain à l’état brut(e) ne tombe à terre.
Alors que les applaudissements se font chaleureux, “face au mur” (beau clin d’oeil à l’autre mise en scène de Colas actuellement au Gymnase), des prénoms de toutes les nationalités se projettent sur son dos comme un monument aux vivants.
La terre patrie défile. Sublime.
” Mon képi blanc”de Sonia Chiambretto par Hubert Colas a été joue le 6 octobre 2007 dans le cadre d’Actoral.6

La cour du lycée Saint-Joseph accueille Krzysztof Warlikowski, pour « Angels in América I et II ». Ce metteur en scène polonais, habitué du festival d’Avignon, est un réconciliateur. En 2005, au coeur de la tourmente provoquée par l’artiste associé de l’époque (Jan Fabre), « Kroum » avait fait l’effet d’un baume apaisant. Aujourd’hui, il revient pour nous conter le roman de Tony Kushner sur les années sida dans l’Amérique de Reagan. Cette tragédie fait trembler les murs et les gradins, réveille le mistral glacial, et résonne dans cette France décidément bien trop calme.
En juin dernier, le Festival Montpellier Danse s’interrogeait et commémorait les victimes: comment le sida a-t-il influencé la danse ? Quel rôle joue-t-il aujourd’hui ? Comment alerter l’opinion publique sur le drame qui secoue l’Afrique ? Avignon prolonge le débat en inscrivant l’épidémie à l’articulation du politique et de l’intime. Curieuse coïncidence tout de même au moment où l’équipe de Sarkosy, néolibérale et puritaine, brouille les cartes, abat les cloisons pour clore les controverses et marginaliser un peu plus ceux qui pensent différemment. Le théâtre de Warlikowski est donc une bouffée d’oxygène qui repositionne la marginalité au coeur du progrès social, du processus créatif et invite les hétérosexuels (majoritaires) à cesser de considérer l’homosexualité à partir de leur moralité, qu’ils reconnaissent au Sida sa dimension sociale, politique et culturelle. Ces 5h30 donnent à cette tragédie les images d’un film de David Lynch, les métamorphoses d’un Roméo Castellucci, les rythmes d’un Joël Pommerat. Warlikowski réunit mes références théâtrales, incarne mon histoire face au sida dans le jeu exceptionnel des acteurs pour la restituer en fresque vivante.

Deux hommes s’aiment ; l’un est atteint du sida, l’autre pas. Plus loin dans la ville, un couple se déchire : l’un est attiré par les ballades dans les parcs pour y observer les hommes, l’une prend des cachets dans l’attente d’avoir un enfant. À côté de ces amoureux transits, un avocat, proche de l’équipe Reagan, a le sida qu’il dissimule en cancer, hanté d’avoir plaidé la peine de mort pour Ethel Rosemberg. Tous les acteurs de cette tragédie sont reliés, mais profondément isolés dans leur souffrance. Ils sont des marionnettes manipulées par les oligarchies religieuses, enfermés dans les jeux de leur caste professionnelle, prisonnier de leur idéologie. Qui tient les fils ? Comment s’en échapper ?

C’est là que Warlikowski démontre toute la puissance de son art : guérir du « sid’amour », c’est ouvrir les espaces de dialogue, libérer les peurs, tisser des liens de solidarité, laisser la place à l’inconscient pour qu’il fasse son travail d’introspection et de réparation. A l’image de l’unité de lieu (grande pièce aux murs argentés, au mobilier d’un ancien pays communiste, à la fois salle d’église et de réunion du parti) qu’il transforme en chambre d’hôpital, en pays imaginaire de l’Antartique, en coulisse de la mort pour mieux relier, élargir là où le sida enferme, cloisonne, tue à petit feu. La mise en scène de Warlikowski est une approche politique face à une maladie réduite par les hétérosexuels à la sphère de l’intime. Elle met en mouvement le lien que les malades ont tissé avec leurs proches: dire, mais pas tout, suggérer pour éviter le voyeurisme, donner du sens à l’inacceptable pour préserver la vie. Warlikowski a tout compris de cette maladie, de sa complexité, mais aussi des enjeux sociétaux : ce sont les minorités qui enclenchent le changement. Il ne simplifie rien, mais ouvre en permanence jusqu’à la scène finale où tous les acteurs assis face à nous, dissertent sur le sens de la vie, nous aident à nous réapproprier la question du sida, facilitent le passage de la fiction à la réalité (l’histoire est toujours en oeuvre avec ce virus).
Deux jours après, une spectatrice me confiera : « il ne faudrait pas réduire « Angels in América » à une pièce sur les homosexuels ». Qui lui parle de réduire ?
Pascal Bély
www.festivalier.net
« Angels in América » par Krzysztof Warlikowski a été joué le 20 juillet 2007 dans le cadre du Festival d’Avignon.
Crédit photo: © Christophe Raynaud de Lage/Festival d’Avignon


Attendez-moi, j’arrive…
Pascal Bély
www.festivalier.net
Genèse n°2 par Galin Stoev a été joué le 20 juillet 2007 dans le cadre du Festival d’Avignon.
Crédit photo: © Christophe Raynaud de Lage/Festival d’Avignon



