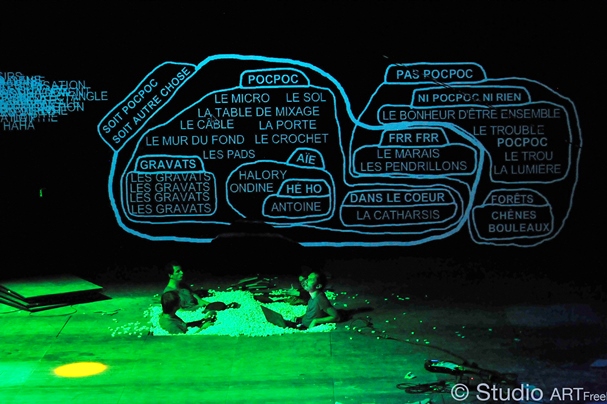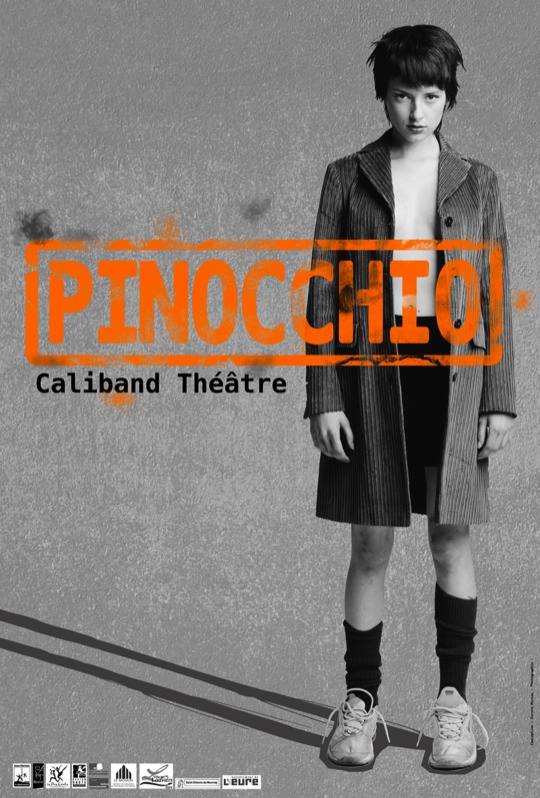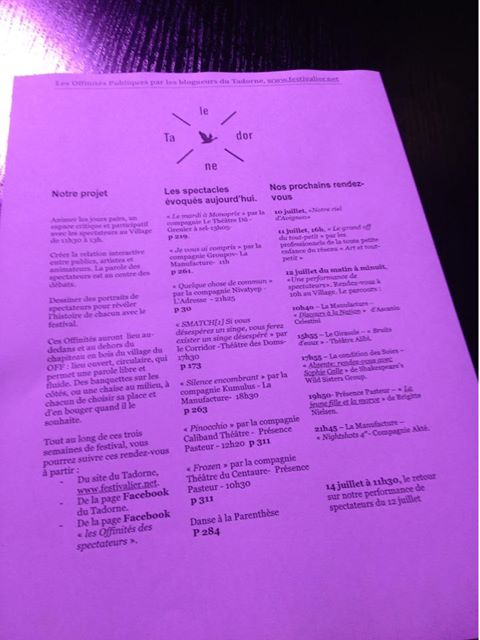14 juillet 2013 – 11H30 – En introduction de l’Offinité Publique au Village du Off.
Nous, Pascal Bely et Sylvie Lefrère, co-animons les rencontres critiques au Village du Off, «Les Offinités publiques du Tadorne». Tadorne, nom du blog, est un canard migrateur. Comme lui, nous nous retrouvons chaque mois de juillet, avec Sylvain Saint-Pierre de Paris, Laurent Bourbousson d’Avignon, Bernard Gaurier de Rennes, Francis Braun de Saint Rémy de Provence. Nous suivent à distance, Pierre-Jerôme Adjej de Berlin, Pascale Logié de Lille, Nicolas Bertrand de Lyon…Passionnés, nous sommes spectateurs acteurs et pensons nos choix dans un travail continu de recherche où nos ressentis et notre quête de sens se relient.
Suite à l’exposition «Nuage» proposée par le musée Réattu d’Arles, nous entamions il y a dix jours notre festival à partir de la métaphore du ciel. En dix jours, nous avons quitté notre ciel imagé évoqué lors de la première Offinité publique du 10 juillet, pour nous rapprocher de la matière, du vivant, de la terre charnelle à labourer. Pour cela, nous avons créé le vendredi 12 juillet, un parcours de spectateurs de 10 heures à minuit. Il nous a guidé sur une ligne politique, un cheminement citoyen. De la crise actuelle, le théâtre nous a fait entendre le bruit de cette planète, qui ne tourne plus très bien et de la nécessité de penser, d’agir, de redoubler de clairvoyance en collectif, à la recherche de sens. Notre programme nous a entraîné dans un territoire global aux frontières poreuses.
Tout d’abord en Italie, sous le rythme de la syntaxe d’Ascanio Celestini. Nous avons écouté «Le discours à la nation» avec David Murgia, comédien belge et tribun aux multiples casquettes. Il incarne un petit bonhomme, homme de pouvoir, porteur d’un revolver (comme tant de ses concitoyens), protégé par son parapluie qu’il daigne offrir pour mieux écraser son hôte. Il manie l’injonction paradoxale avec délice et l’inclus dans une ritournelle qui ouvre nos rires, non vers un cynisme facile, mais vers une pensée en mouvement. À mesure que le discours avance, il nous impose une évidence : «la démocratie est une dictature». Sa démonstration est implacable: nous ne choisissons plus nos dirigeants, c’est eux qui nous choisissent. Nous ne luttons plus contre l’exclusion sociale: c’est l’exclusion qui nourrit les puissants. «Le discours à la nation» est passionnant parce qu’il est écrit du côté de ceux qui détiennent le pouvoir (ici, économie, politique et social ne font qu’un, sans plus aucun mécanisme de régulation). Cela pourrait se passer en France, pays où il pleut tout le temps (probablement lié au réchauffement climatique). Bienvenue en 2063.
Quelques heures plus tard, retour vers le passé pour vivre un «ici et maintenant» bouleversant. «Exhibit B” est une exposition proposée à l’Église des Célestins dans le cadre du festival «In». Brett Bailey est un artiste blanc d’Afrique du Sud. Il a connu l’apartheid. Son exposition performance est incarnée par quinze acteurs amateurs, tous immobiles, mais dont le regard crée l’Histoire en mouvement. De la Vénus Hottentote, aux camps de la mort, aux sans-papiers d’aujourd’hui, tout le poids de l’histoire des noirs s’écrase sur nous. La violence dont ils ont été victimes tout au long des siècles rôde sous les alcôves de l’Église. Elle nous revient à partir d’un geste artistique d’une très grande beauté. Assis, couchés, debout, ces hommes et ces femmes nous font face, habillés par leur dignité. Nous nous ressentons aumônier dans le couloir de la mort. Impuissants, sans pouvoir formuler un mot. C’est une transe silencieuse qui nous envahit, où nos corps chavirent sous la puissance de l’échange.
Quelques minutes plus tard, une passerelle s’est spontanément ouverte vers «Bruits d’eaux» de Marco Martinelli, mise en scène par Catherine Graziani. L’acteur François Bergoin est notre capitaine d’embarcation dans cette lente descente en enfer que sont devenues les traversées de clandestins en méditerranée. À l’heure où l’hystérie médiatique empile les sujets d’actualité pour mieux les effacer de nos mémoires, le théâtre nous rappelle que si certains d’entre eux ont quitté la une de nos journaux, ils occupent notre (mauvaise) conscience d’Européen. À la crise que vivent bon nombre de nos concitoyens en Europe, s’ajoutent silencieusement les bateaux de fortune qui continuent de s’échouer sur nos côtés, notamment sur celles de l’île de Lampedusa. Si petite qu’elle n’est plus qu’une poussière glissée sous l’épais tapis de nos palais. «Bruits d’eaux» va délicatement raviver notre conscience d’Européen à l’heure où le politique démissionne sous le poids des injonctions des marchés.
De l’Italie à l’Asie…il n’y a eu que quelques rues pour nous diriger vers La Condition des Soies où nous attendait «Absente, rendez-vous avec Sophie Calle» de Chou Man-nung. Nous avons posé un pied sur le sol en papier plié, petit origami de Taiwan, pour fouler l’univers de la plasticienne française. C’est une œuvre profondément exigeante qui force notre écoute tant le danseur Shai Tamir est fulgurant dans sa légèreté amoureuse.
Douce transition pour atteindre le tunnel de «La jeune fille et la morve» de Mathieu Jedrazak, l’un des spectacles les plus forts de ce festival. Au centre d’une recherche de sens dans un carcan éducatif, un être hybride nous tient en haleine à la recherche de son identité, de sa lutte contre ses phobies qui peu à peu résonnent avec les nôtres. Un certain état de la France au cœur d’une quête intime époustouflante.
Après treize heures de parcours dans le festival Off, la compagnie Akté clôture cette journée marathon. Le sujet grave des addictions des rocks stars nous détend en nous laissant envahir par les mélodies connues. Mais l’esprit rock est quasiment absent de la scène. Un certain état de la France…
Cette journée a été très dense et n’a été possible qu’en s’appuyant sur une dynamique de groupe et une finalité partagée. L’expérience sera renouvelée en 2014, avec probablement une implication plus importante des compagnies et de groupes plus ou moins institutionnalisés (associations, réseaux professionnels, collectivités locales). Un appel à projets sera lancé en ce sens début 2014.
Sylvie Lefrère – Pascal Bély – Tadorne
14 juillet 11h45 – Débats critiques avec les spectateurs.
Ce matin, dimanche 14 juillet, c’est notre troisième Offinité. Nous avons nos habitués et de nouveaux spectateurs qui viennent puiser des idées dans nos rencontres. Certains arrivent et prennent des notes, d’autres ont déjà des petits carnets noircis.
Le ressenti du public pointe la dépression des sujets choisis. L’art met en scène nos perspectives. La création dans le contexte actuel ne peut pas produire des oeuvres légères. Mais dans la forme, la créativité nous donne l’énergie de laisser entrouvrir nos désirs d’utopie.
Les spectacles fortement recommandés lors de l’Offinité du 14 juillet.
«Discours à la nation» d’Ascanio Celestini-10H40-La manufacture-P 260
«Bruits d’eaux» de Christiane Graziani-15H55- Au Girasole-P 210 (critique de Pascal Bély)
«Absente : rendez vous avec Sophie Calle» de Shakespeare’s Wild Sisters group – 17H55- La Condition des Soies- P157
«La jeune fille et la morve» de Mathieu Jedrazak-19H50-Présence Pasteur-P 315 (critique de Sylvain Saint-Pierre)
«Savez vous que je peux sourire et tuer en même temps» par la compagnie Ches panses vertes -17H30- Girasole- P 210
«Orphelins» par le Théâtre du Prisme-17h45 -Présence Pasteur- P 314.
«Pinocchio» par la compagnie Caliband Théâtre -Présence Pasteur – 12h20. p 311 (critique de Laurent Bourbousson et Sylvain Saint-Pierre)
«Pour un oui ou pour un non» par la Compagnie Pourquoi ?–Vieux Balancier–11h-p 353
«Une douce imprudence» d’Eric Lamoureux et Thierry Thieû Niang- Hivernales- 10h – P 226
«L’incroyable destin de René Sarvil, artiste de Music-hall» par les Carboni–Théâtre des Carmes – 15h30 – p 104.
Les spectacles déjà recommandés lors des Offinités précédentes :
«Le mardi à Monoprix» par la compagnie Le Théâtre Dû – Grenier à sel-13h05- p 219 (critique de Sylvie Lefrère)
«Je vous ai compris» par la compagnie Groupov- La Manufacture- 11h – P261 (critique de Pascal Bély et Sylvie Lefrère)
«Quelque chose de commun» par la compagnie Nivatyep – L’Adresse – 21h25- P30 (critique de Laurent Bourbousson et Sylvain Saint-Pierre)
«Silence encombrant» par la compagnie Kumulus – La Manufacture- 18h30 -p 263
«Frozen» par la compagnie Théâtre du Centaure- Présence Pasteur – 10h30 -p 311
« SMATCH[1] Si vous désespérez un singe, vous ferez exister un singe désespéré » par le Corridor -Théâtre des Doms- 17h30 – p 173 (critique de Pascal Bély)
“Qui sommes-je?” de Ludor Citrick – Espace Vincent de Paul – 15h30- p 197 (critique de Pascal Bély)
“Les beaux orages qui nous étaient promis” par le Collectif Petit Travers – Espace Vincent de Paul – 17h- p 197
JEUNE PUBLIC
«Concert-tôt» par l’Ensemble FA7 – Maison de théâtre pour enfants – 9h45 et 15h45 – p 256
«C’est dans la poche» – Compagnie Jardins Insolites – Maison de théâtre pour enfants – 9h50– p 256
«Papa est en bas» – Compagnie La Clinquaille – Maison de théâtre pour enfants – 10h30 – p 256
«Le papa-maman» – Compagnie La Parlotte – Maison de théâtre pour enfants – 10h40 – p 256
«Camion à histoires» par la compagnie Lardenois – Maison de théâtre pour enfants – 11h et 16h40– p 256
Nous nous retrouvons le 18 juillet à 11h30 pour l’Offinités 4, autour du théâtre du monde.