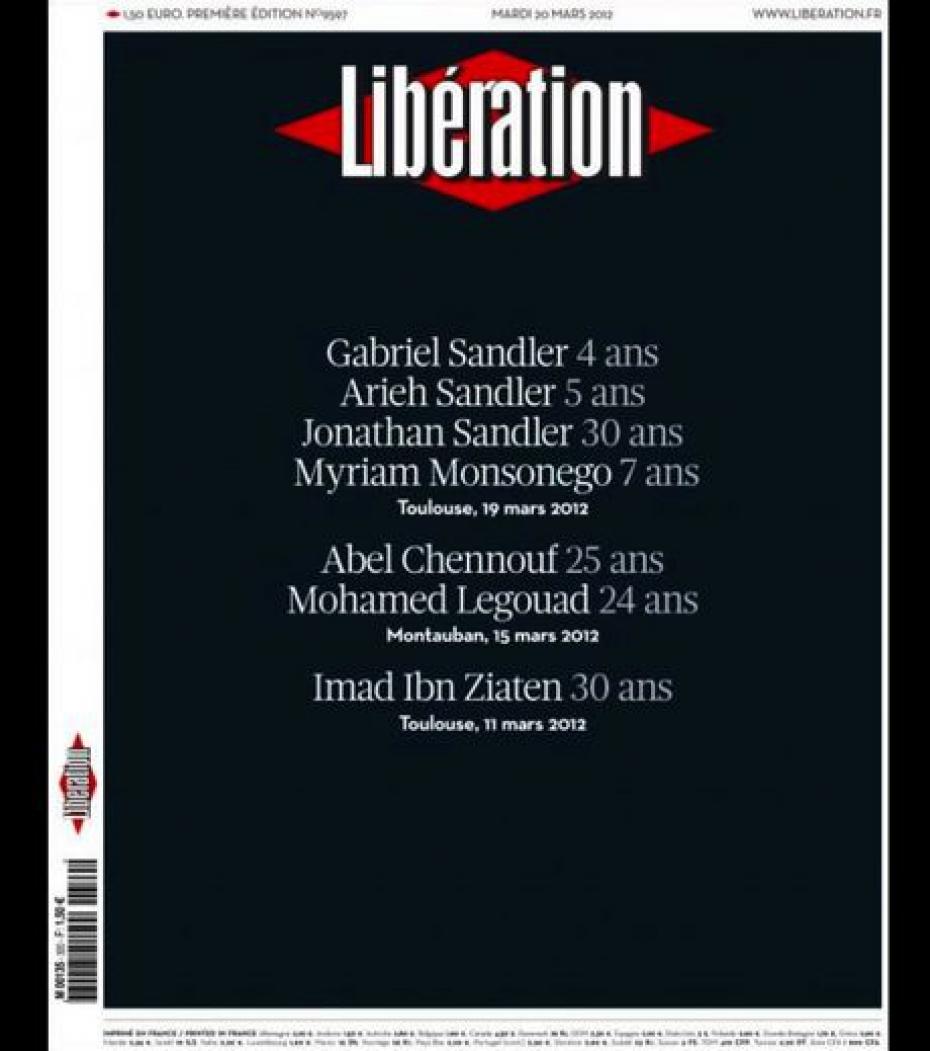Pendant le Festival d’Avignon, j’aime nos échanges de spectateurs sur notre groupe Facebook. Ils sont sans concession. À propos de «Par les villages», mise en scène de Stanislas Nordey, Francis Braun écrit: «Je suis prêt à me battre pour défendre ce spectacle». Pascale s’impatiente: elle attend des propos plus étayés ! Nicolas, fidèle lecteur, lui répond: «Ça va venir. Les Tadornes s’invectivent et se défient avant la bataille d’arguments».
Je n’ai pas vu la pièce, mais le texte de Francis Braun est un sacré coup d’épée. En plein cœur.
Pascal Bély.
———————————————————————————————————————————————————————-
“Les cloches n’appellent pas le temps, elles appellent l’Éternité”.
“Ah bas les sculptures de racines…”
Force de constater qu’il ne reste que ce ruisseau qui ne coule plus. Force de constater que le béton bloque tout.
Comme beaucoup, ils crient. Très fort, ils pensent que “personne ne peut tout”.
La pièce de Peter Handke, «Par les villages», mise en scène de Stanislas Nordey, n’est pas silencieuse. Elle est dénuée de bruit artificiel et les comédiens, tous en ligne, respectent son écriture… Disparu, le lien tutélaire. Il y a encore moins de protection, tout est remplacé, l’eau, la terre, le feu, les écoulements, les brûlures. C’était différent avant et ce n’est pas, là, une banalité. Et ils le racontent, tous, ce changement, cette société, ce bouleversement. C’est ainsi que quatre heures durant, ils font cet effrayant constat qui nous enfouit dans un amalgame bétonné.
Stanislas Nordey, Jeanne Balibar, Emmanuelle Béart, et des superbes seconds rôles (magnifiques comédiens) sont là. Des ouvriers, maîtres d’œuvre ou artistes géniaux nous racontent sans emphase. Une mise en scène sévère, rectiligne sans artifice. On oublie l’année dernière Simon Mac Burney: il n’y a pas de vidéo, il n’y a pas de gadget.
Retour à l’admiration du verbe, du texte, des dires devant 2000 personnes, juge et partie assis tous de face, admirateurs ou obstacles, pour ou contre, public sévère d’Avignon. Stanislas Nordey veut, dit-il, parler à l’intime de chaque regard. Metteur en scène et comédien, il est là, fougueux, volontaire, puissant convaincant, incisant poignard, truelle maçonne, outil de la persuasion.
Ils re-disent parfois….”Ah bas les sculptures de racines”….
Stanislas Nordey mène sa troupe serrée, sans gesticulation. Ancrés, ils sont debout sur ce sol quelconque et devant des baraques de chantier traditionnelles (la Carrière Boulbon aurait-elle été préférable que la Cour….je pense). Le décor insignifiant, n’ajoute rien, n’enlève rien. Dans la seconde partie, les arbres blancs que compose cette façade plaquée et végétale d’un cimetière livide ne dérangent pas plus que leurs ombres esquissées…finalement on s’en moque un peu. C’est un lieu de fin de vie, c’est un lieu de retrouvailles, c’est le lieu extrême de la fin. Aucune intégration avec les pierres séculaires, juste une cohabitation. Catherine Ribeiro aurait aimé ce “Carrefour de la solitude”, ce lieu indéfinissable et vivant du passé et de la mort (je pense à Catherine Ribeiro grande amie de Colette Magny à qui l’intendante du chantier Annie Mercier me fait penser par la force de sa violence).
Ce décor pour moi n’existe même pas. J’arrive à l’ignorer tant les voix me harcèlent.
Les voix des hommes, les voix des femmes.
Emmanuelle Béart, plus habituée au Cinéma qu’au Théâtre est une voix rauque, coléreuse, voire parfois hargneuse. Le poing souvent serré de sa main nous dit la violence de son propos, mais il sonne comme un écho fabriqué, comme une volonté forcée plutôt que venant d’une injonction naturelle. Sa petite taille devant le mur l’ancre sur la Terre Bétonnée. Elle aurait pu disparaître dans la terre meuble. Je doute de ce choix de comédienne.
Emmanuelle Béart est seule, Jeanne Balibar est seule, Annie Mercier est seule, les ouvriers sont seuls et cette aventure par les villages est un peu un chemin de solitude, un chemin où se cognent non seulement le désarroi et les déceptions, mais aussi les regrets et les amertumes. La civilisation nous convie à la solitude.
Jeanne Balibar est seule. Seule à talons, yeux dans le vague, bouche haletante. Nova de sa hauteur parle. Elle monologue. Linéaire ses paroles, comme sur un fil, droite, parallèle à ce qu’elle doit dire, toujours rectiligne. Des hauts dans sa voix, des bas trémolos inquiétants. Pas de morale dans les syllabes, des conseils plutôt, des dires sur l’Art salvateur. Elle est implacable. Elle me fascine par sa ténacité verbale et la persuasion de son rictus. Elle se parle à elle-même comme si elle parlait aux Dieux d’une Tragédie. J’aurais pu l’écouter longtemps, plus longtemps parler de la création, de la source bienfaisante de l’Art, des démarches créatrices.
L’Art intemporel, l’Art solution extrême, seule échappatoire, l’’Art au dessus de toutes les contingences mercantiles ( ??? !!!). L’Art pour les humbles, l’Art pour les oppresseurs, l’Art pour les opprimés. L’Art, l’issue évidente.
Quatre heures bien sûr, c’est long, c’est envoutant, mais l’esprit parfois s’en va, nous laisse à la dérive. Seule, la puissance de la mise en scène, seul le talent de ces hommes et de ses femmes nous emporte, nous tient éveillés…Je suis resté accroché à Balibar.
Il est maintenant presque 1.30. On ne plaisante plus. La gardienne du cimetière se lève, les autres aussi, l’enfant fil conducteur a les yeux qui clignotent. Bas les masques, ou plutôt, mettez vos masques, continuez ainsi, les masques vous protègent, ils sont l’image de votre cachotterie, de la notre, de la leur….
Rien ne sert à rien, les masques ne tombent pas…on n’y peut rien…
Toute la troupe, à la fin se lève, ils nous regardent, se regardent, portent à la main des masques de bois, dont il recouvre leurs visages…j’allais dire leurs VILLAGES !
Debout. Applaudissements.
Jeanne Balibar est grande et émue, il semble qu’Emmanuelle Béart pleure….
Francis Braun – Tadorne
“Par les villages” – Peter Handke, mise en scène de Stanislas Nordey à la Cour d’Honneur - Festival d'Avignon – 6.7.2013