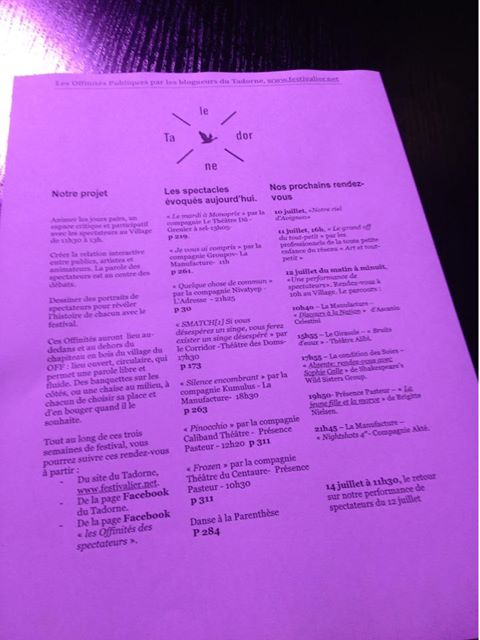Ce rendez-vous des Offinités publiques est notre projet de spectateurs. Il est animé par moi-même Pascal Bély, Sylvie Lefrère, Sylvain Saint-Pierre, Laurent Bourbousson, Bernard Gaurier. Loin d’ici mais présents : Pierre-Jérôme Adjej à Berlin et Pascale Logié à Lille. Chaque année, nous croisons nos sensibilités et nos approches du théâtre en encourageant un regard critique capable de nous faire penser collectivement sur ce qui fait société, ce qui fait politique. Nous cherchons en nous ce qui fait conscience du monde, ce qui relie notre intime complexe aux enjeux mondialisés de l’humanité. C’est ainsi que nous pensons notre place de spectateur pour la mettre en mouvement, la questionner en continu pour ne rien figer et ne rien sacraliser.
Nous avons placé notre rendez-vous d’aujourd’hui sous le thème engloblant du théâtre monde. Comment s’évoque le monde au Festival Off d’Avignon ? Pour animer ce rendez-vous, nous avons convié Mahoro Nsengimana et Ivan Guibert de la section “personnes déracinées” d’Amnesty International France et des metteurs en scène Catherine Graziani et Julien Bouffier. Nous les invitons à écouter ce qui va s’éclairer sur le programme du OFF à partir de nos critiques et de faire liens entre leurs visions d’artistes et de militants.
Avant de commencer ce tour critique, j’aimerais évoquer quelques artistes qui nous ont profondément marqués depuis le début du Festival. Nous y sommes depuis le 5 juillet. Tout a commencé au In avec l’espagnole Angelica Liddell. Cela ne pouvait pas mieux tomber. Car «Ping Pang Qiu» est un vibrant plaidoyer pour un théâtre engagé et engageant. Il évoque la bataille à mener: celle d’affirmer nos modes d’expression contre les approches rationalistes et autoritaires qui visent à les museler. Elle est entrée dans l’arène avec une robe rouge sang, comme l’énergie qui coule dans ses veines; rouge vif comme la colère qui gronde en elle; rouge vif comme la couleur du petit livre de Mao qu’elle brandira à plusieurs reprises pour le défier. Mais combien sont-ils en Europe à brandir leur petit manifeste pour nous imposer leur politique libérale sans vision?
La vision d’Angélica s’est amplifiée avec David Murgia, dans «Discours à la Nation», comédien belge et tribun aux multiples casquettes. Il incarne un petit bonhomme, homme de pouvoir, porteur d’un revolver (comme tant de ses concitoyens), protégé par son parapluie qu’il daigne offrir pour mieux écraser son hôte. Il manie l’injonction paradoxale avec délice et l’inclu dans une ritournelle qui ouvre nos rires, non vers un cynisme facile, mais vers une pensée en mouvement. À mesure que le discours avance, il nous impose une évidence : «la démocratie est une dictature ». Sa démonstration est implacable: nous ne choisissons plus nos dirigeants, c’est eux qui nous choisissent. Nous ne luttons plus contre l’exclusion sociale: c’est l’exclusion qui nourrit les puissants. «Le discours à la nation» est passionnant parce qu’il est écrit du côté de ceux qui détiennent le pouvoir (ici, économie, politique et social ne font qu’un, sans plus aucun mécanisme de régulation). Cela pourrait se passer en France, pays où il pleut tout le temps (probablement lié au réchauffement climatique). Bienvenue en 2063.
Retour vers le passé pour vivre un «ici et maintenant» bouleversant. “Exhibit B” est une exposition proposée à l’Église des Célestins dans le cadre du festival «In». Brett Bailey est un artiste blanc d’Afrique du Sud. Il a connu l’apartheid. Son exposition performance est incarnée par quinze acteurs amateurs, tous immobiles, mais dont le regard crée l’Histoire en mouvement. De la Vénus Hottentote, aux camps de la mort, aux sans-papiers d’aujourd’hui, tout le poids de l’histoire des noirs s’écrase sur nous. La violence dont ils ont été victimes tout au long des siècles rôde sous les alcôves de l’Église. Elle nous revient à partir d’un geste artistique d’une très grande beauté. Assis, couchés, debout, ces hommes et ces femmes nous font face, habillés par leur dignité. Nous nous ressentons aumônier dans le couloir de la mort. Impuissants, sans pouvoir formuler un mot. C’est une transe silencieuse qui nous envahit, où nos corps chavirent sous la puissance de l’échange.
Trois visions de ce théâtre monde que nous allons nourrir et amplifier au cours de ce rendez-vous où seront abordés par les Tadornes, les spectacles suivants :
« Bruits d’eaux » – Théâtre Alibi – Le Girasole – 15h55– P 210
Trois corps circulent sur le plateau, métaphore de notre embarcadère d’un soir. Un homme, petit (sidérant François Bergoin), porte un costume de capitaine bien trop grand où le bruit de ses médailles rappelle la cloche de nos vaches. Sorti du troupeau des petits fonctionnaires obéissants, il s’avance vers nous, sûr de notre bon droit : protéger l’Europe de l’immigration sauvage. À ses côtés, un étrange objet inanimé m’intrigue. Sa présence fait corps comme s’il avait été sculpté sous la torture. À la fois totem et tabou. À la fois bureau de ce chef comptable préposé à la politique du chiffre (compter les noyés) et symbole de l’échafaud pour accostage illégal de nos côtes. Construit par l’Atelier MOA, il est à la fois fragile et oppressant quand s’y assoit le comptable et puissant dans sa verticalité lorsqu’une de ses « poutres » se fait scène pour accueillir la chanteuse et musicienne Sika Gblondoume. Ses mouvements fantomatiques, appuyés par les écrins de lumières et vidéos de Fabien Delisle, font entendre des berceuses du Bénin ou d’Algérie et donnent une présence incroyable à ces noyés ensevelis sous les planches de ce radeau de la méduse. Cette femme ouvre les portes, pose des ponts…elle est fille d’Istanbul, entre Afrique et Europe.
« Je vous ai compris » par la compagnie Groupov- La Manufacture- 11h – P261
Cinquante ans après, deux comédiennes, Valerie Gimenez et Sinda Guessab, nous font vivre de l’intérieur l’allocution mythique du Général de Gaulle à Alger. Elles incarnent un couple improbable, celui de leurs parents: un gendarme pied-noir (militant du Front National) et une Algérienne naturalisée française. Leur histoire originelle est différente et distanciée, mais le contexte politique actuel les relie: face à nous, elles font ce travail d’introspection que la France ne veut pas entamer.
«Je vous ai compris» est une œuvre forte, car elle célèbre la liberté d’expression: ouvrir la parole intime de chacun pour penser une politique pour tous. Il faut un sacré courage pour oser un tel rendez-vous avec l’Histoire et accompagner le spectateur à faire ce travail d’introspection. Car ne nous y trompons pas: cinquante ans après, l’expression de De Gaulle agit comme un secret de famille.
«Qui sommes-je?» de Ludor Citrick – Espace Vincent de Paul – 15h30- p 197.
Ce clown accumule des souffrances (seraient-elles celles du corps social?) provoquées par les brimades de la société du spectacle qui transforme nos espaces de liberté en camp retranché. Notre clown les déjoue en détournant les mots pour interroger notre vivre ensemble, nos dualités entre le masculin et le féminin, nos cloisons entre pensée et plaisir…Il ne cède jamais à la plainte, mais redéfinit en permanence le cadre pour interagir. Il souffre pour réveiller notre clown d’aujourd’hui, humanoïde hybride entre raison et déraison qui dépasse nos systèmes de pensée usés et normés.
Notre clown est si fort qu’il rend l’animateur totalement dépendant. Il a toujours une longueur d’avance jusqu’à guider sa pulsion de faire mal vers l’endroit où cela pourrait lui faire du bien ! Il cherche toutes les ouvertures là où rien n’est à priori fermé ! Tenu en laisse par son gardien de tôle, il n’hésite pas à franchir la ligne blanche, vient vers nous, nous provoque dans notre confort et nous prendre à témoin pour rendre justice.
«Illuminations» par la Madani Compagnie- Théâtre des Halles – 19h – p 223.
Comment porter sur scène le lien entre les événements de la Guerre d’Algérie et les émeutes dans les banlieues de 2005 ? Avec «Illumination(s)», Ahmed Madani a réussi ce pari politique et artistique en invitant huit jeunes d’un quartier populaire dans un récit choral où s’entremêlent les récits de trois générations d’immigrés.
Ici, la confusion est une force car elle brouille les repères chronologiques. L’histoire est vue comme un processus et non comme un état de fait. Les événements d’Algérie sont intimement et collectivement intégrés dans les émeutes de 2005. La culpabilisation des ainés et leur soumission à la France sont portées par les jeunes d’aujourd’hui qui questionnent avec créativité et colère les valeurs de la république. Aux tortures d’hier répondent la violence des rapports sociaux d’aujourd’hui. Le récit non linéaire est une aide pour penser la France comme un pays d’immigration, en dynamique, en changement. Tout est proposé dans des causalités circulaires comme par exemple l’origine des vigiles qui protègent les lieux publics et centres commerciaux : “Nous devenons vigiles pour vous protéger de nous mêmes”.
«Illumination(s)» est une pièce où le changement de regard est possible si nous faisons ensemble un travail de mémoire. L’art et ces nouvelles esthétiques pourraient nous y aider : en faisant dialoguer les époques, en privilégiant une approche transversale de l’immigration, en repensant la place des femmes, beaucoup trop invisible.
«übü kiraly » d’Alain Timar – Théâtre des Halles– 11h–p 222.
1h50 d’un théâtre qui passe à toute vitesse. Alain Timar est allé “s’accoquiner” avec des acteurs roumains exceptionnels. “Ubu papa”, “Ubu maman” et toute leur clique inventent un théâtre où le papier omniprésent symbolise ce pouvoir qui se froisse pour un oui ou pour un non; ce pouvoir qui déchire les âmes pour régner sans toi, ni loi.
Superbe.
«Ali 74, le combat du siècle » par Nicolas Bonneau – Le Girasole – 20h55 – p 210
A priori, ce n’est pas un spectacle que j’aurais sélectionné. Des amies s’en sont chargées. Je suis entré dans cette salle, métaphore du ring d’un artiste. Le «ciné-récit- concert» de Nicolas Bonneau est une lutte de tous les instants où il combat certains réflexes du théâtre dit documentaire. En tout premier lieu, il évite une narration linéaire pour évoquer le combat du siècle entre les boxeurs Mohamed Ali et Georges Foreman. C’était tentant. Mais il inclut dans son spectacle tout un contexte politique (le sort des noirs aux USA, le système Mobutu) ainsi que des images liées à la boxe empruntées au cinéma ou à la bande dessinée. Nicolas Bonneau joue avec sa voix et son corps pour incarner une danse, celle de la boxe, car c’est ainsi que la qualifiait Mohamed Ali. La présence d’un musicien (Mikael Plunian) et d’une chanteuse (Fannytastic) renforce la forme hybride d’un spectacle à la frontière d’un one man show et d’un concert. La présence de l’accordéon fait entendre les corps qui souffrent tandis que la voix murmure rêves, complots et douleurs. C’est un théâtre vif, combattant, haletant car «la boxe, c’est de l’amour», clame Nicolas Bonneau au cours d’un sublime moment théâtral. J’ai la boxe, danse de l’amour et du corps politique.
«End/Igné» par la compagnie du Bredin – La Manufacture – 14h – p 261
“End/Igné”, un texte poétique et cru pour dire un monde violent et tenter de comprendre. Là où le théâtre et l’acteur gomment l’éloignement de bruits d’un ailleurs pour les guider jusqu’à nous et nous faire entendre l’intime où s’inscrit un acte public. Aucune “lourdeur” dans cette proposition, juste une pièce à voir et écouter.
Les autres spectacles fortement conseilllés par les spectateurs présents aux Offinités:
«Le réveil» par la compagnie Trésors de Sophie – L’Adresse- 10h45 – p 29
«Absente : rendez vous avec Sophie Calle» de Shakespeare’s Wild Sisters group – 17H55- La Condition des Soies- P157
«La jeune fille et la morve» de Mathieu Jedrazak-19H50-Présence Pasteur-P 315 (critique de Sylvain Saint-Pierre)
«Savez vous que je peux sourire et tuer en même temps» par la compagnie Ches panses vertes -17H30- Girasole- P 210
«Orphelins» par le Théâtre du Prisme-17h45 -Présence Pasteur- P 314.
«Pinocchio» par la compagnie Caliband Théâtre -Présence Pasteur – 12h20. p 311 (critique de Laurent Bourbousson et Sylvain Saint-Pierre)
«Pour un oui ou pour un non» par la Compagnie Pourquoi ?–Vieux Balancier–11h-p 353
«Une douce imprudence» d’Eric Lamoureux et Thierry Thieû Niang- Hivernales- 10h – P 226
«L’incroyable destin de René Sarvil, artiste de Music-hall» par les Carboni–Théâtre des Carmes – 15h30 – p 104.
Les spectacles déjà recommandés lors des Offinités précédentes :
«Le mardi à Monoprix» par la compagnie Le Théâtre Dû – Grenier à sel-13h05- p 219 (critique de Sylvie Lefrère)
«Quelque chose de commun» par la compagnie Nivatyep – L’Adresse – 21h25- P30 (critique de Laurent Bourbousson et Sylvain Saint-Pierre)
«Silence encombrant» par la compagnie Kumulus – La Manufacture- 18h30 -p 263
«Frozen» par la compagnie Théâtre du Centaure- Présence Pasteur – 10h30 -p 311
« SMATCH[1] Si vous désespérez un singe, vous ferez exister un singe désespéré » par le Corridor -Théâtre des Doms- 17h30 – p 173 (critique de Pascal Bély)
“Les beaux orages qui nous étaient promis” par le Collectif Petit Travers – Espace Vincent de Paul – 17h- p 197
JEUNE PUBLIC
«Concert-tôt» par l’Ensemble FA7 – Maison de théâtre pour enfants – 9h45 et 15h45 – p 256
«C’est dans la poche» – Compagnie Jardins Insolites – Maison de théâtre pour enfants – 9h50– p 256
«Papa est en bas» – Compagnie La Clinquaille – Maison de théâtre pour enfants – 10h30 – p 256
«Le papa-maman» – Compagnie La Parlotte – Maison de théâtre pour enfants – 10h40 – p 256
«Camion à histoires» par la compagnie Lardenois – Maison de théâtre pour enfants – 11h et 16h40– p 256