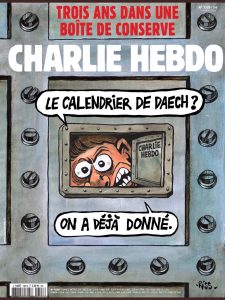Après “Le Petit Chaperon rouge” , “Pinocchio”, Joël Pommerat triomphe avec “Cendrillon“. Mérité. Les contes de notre enfance, nous croyons les connaître par cœur…Mais nous sommes peut-être sourds à leurs battements. Avec son équipe, l’auteur et metteur en scène Joël Pommerat fait un travail d’horloger. Les contes, ils nous les éclatent pour les restructurer, et nous laisser à l’écoute d’une autre partition. Nous entendons une nouvelle musicalité qui quitte nos chansons douces, pour rejoindre notre intime, caché, là…Un homme vient ponctuer régulièrement la pièce, dans une expression en langage des signes. Finalement, ne sommes-nous pas tous un peu malentendants ?
Le plateau dépouillé s’oppose à l’image habituelle de la féerie des histoires de princesses. Nous partons de loin, très loin dans l’enfance. La comédienne principale est frêle, à la voix enfantine, comme dans les précédentes pièces de la compagnie. De l’enfant s’éveillera une force féminine, sortie de sa chrysalide à coup de reins.
Joël Pommerat va explorer la complexité de la communication ou comment une histoire peut se tisser à partir d’un malentendu . Combien de fois rencontrons-nous de telles situations similaires? En écho, j’entends : “Mais je pensais que…, mais je t’ai dit que … et tu comprends?… Différemment.” Notre histoire, notre culture, notre état, nos préjugés, notre niveau d’intelligence, notre sensibilité peuvent nous donner une autre lecture. Il faut prendre le temps d’écouter. Prendre le temps de reformuler, de questionner. Prendre le temps…C’est devenu un luxe. Le brouhaha ambiant et le stress nous parasitent et nous voilà partis sur une mauvaise piste.
Sur son lit de mort, Sandra aura interprété les paroles de sa mère et partira dans un imaginaire. Voilà comment elle a entendu ce qu’elle attendait. Elle va vivre ainsi, comme le lapin d’Alice au pays des merveilles, à contrôler le temps et tenter de maîtriser sa mémoire…
«Cendrillon» incarne cette lutte contre l’oubli pour se donner une image irréprochable, avec la culpabilité d’en faire toujours plus, jusqu’à se positionner en victime, de mériter de souffrir, de s’auto flageller. C’est ainsi que pendant toute une vie, un enfant peut porter des sentiments infondés et des poids, que seul le psychanalyste pourra révéler, si la démarche est engagée.
Le système matriarcal y est central. Après la mort de sa mère, Sandra fait la connaissance de sa belle mère et de ses deux filles. Elle est baptisée…”Cendrier“. Ce trio donne une image du versant féminin cruel, égocentrique, jugeant et dénigrant. L’image du père offre une personnalité faible, dans ce milieu hostile au genre majoritaire. C’est un combat de coqs. Les femmes dans le pouvoir peuvent être terribles.
Sandra/ Cendrier/Cendrillon, malgré sa petitesse est frondeuse, curieuse et volontaire. Elle supporte tout: les quolibets, les taches multiples. Elle veut être vivante en existant dans le regard des autres. Elle est là, utile, servile. Mais ce n’est pas tout de se réaliser dans ses tâches. Encore faut-il exister pour soi, sous un regard extérieur confiant, qui développe l’épanouissement. Derrière la disparition de la mère, c’est aussi la quête de liberté qui émerge; de l’autorisation de se faire plaisir, d’être heureuse en autonomie et d’aimer un autre.Sa belle mère et ses filles existent, mais dans leur miroir, au dessus des autres. Elles sont la caricature “des laides et des stupides». Ce qui leur manque tant, c’est la sensibilité.
Le public présent est extrêmement réceptif au texte. Des étudiants ont fait le voyage avec leurs professeurs. La fée, d’une modernité à tous crins dans ses propos et ses attitudes, provoque de nombreux rires. Ce sont de douces respirations dans ce cheminement de deuil où le prince est joué par une actrice. Il n’est pas grand, blond aux yeux bleus, mais petit avec un peu d’embonpoint. L’attirance lors de sa rencontre avec Cendrillon s’opére grâce à une histoire commune: la perte de la mère. Orphelins tous les deux, ils sont aussi libérés de ce poids matriarcal…
Le chemin est encore long à parcourir, mais la joie de la libération est là. Après l’amour d’une mère, qu’il est bon de se laisser aller au sentiment amoureux, tourné vers l’étranger et le monde.
Ne sommes-nous pas tous un peu Cendrillon?
Sylvie Lefrere – Le Tadorne
“Cendrillon” de Joël Pommerat:
- Au théâtre des Salins de Martigues les 5 et 6 avril 2024.
- Au théâtre de Serignan, la Cigalière; en partenariat avec Sortie Ouest de Béziers le 13 et 14 mars 2013.