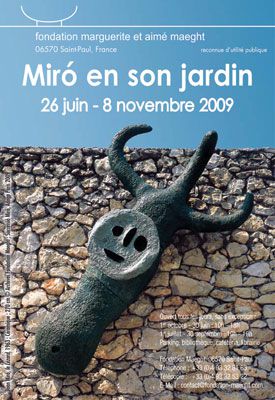Le Festival d'Avignon est un espace de rencontre où l'on échange sur le théâtre sans techniques d'approches ! Lors de la représentation de « Ciels » de Wajdi Mouawad, j'ai osé interpeller Martine Aubry sur la défaite des socialistes aux élections municipales partielles d'Aix en Provence (je passe sous silence sa réponse?sidérante) ? Le même soir, j'ai questionné Leïla Chaid, représentante de la Palestine à Bruxelles, sur les raisons de son absence dans les médias français. Décidement, la file d'attente abat bien des hiérarchies.
 Il en va tout autrement de deux lieux pensés pour le spectateur par le festival et ses partenaires. Les débats à l'Ecole d'Art organisés par le CEMEA (mouvement d'éducation populaire) ont pour finalités de créer le dialogue entre artistes et public. Ils sont trois animateurs : un sur scène, un dans l'assistance, un de côté. En général, le ton est convenu et l'on en profite parfois pour régler des comptes avec la critique (ce fut le cas avec Joël Jouanneau). C'est un jeu de questions ? réponses sans dynamique transversale entre spectateurs. Le CEMEA contrôle, même quand le chorégraphe Rachid Ouramdane regrette l'absence de jugement négatif sur « Les témoins ordinaires ». Qu'importe. Un des animateurs joue le rôle. À d'autres occasions, l'un d'eux formule un avis sur le spectacle et saisit l'opportunité pour énoncer quelques principes chers au CEMEA. Alors que je suis un spectateur plutôt « actif », ils n'ont jamais donné une visibilité à ma démarche. J'avais envisagé que ces débats ouvrent mon blog à des spectateurs. Même si j'ai retranscrit certaines rencontres (Maguy Marin, Wajdi Mouawad, Jan Fabre, Amos Gitaï), cet espace, en reproduisant l'estrade et le parterre, ne m'a pas permis de m'affranchir des barrières hiérarchiques.
Il en va tout autrement de deux lieux pensés pour le spectateur par le festival et ses partenaires. Les débats à l'Ecole d'Art organisés par le CEMEA (mouvement d'éducation populaire) ont pour finalités de créer le dialogue entre artistes et public. Ils sont trois animateurs : un sur scène, un dans l'assistance, un de côté. En général, le ton est convenu et l'on en profite parfois pour régler des comptes avec la critique (ce fut le cas avec Joël Jouanneau). C'est un jeu de questions ? réponses sans dynamique transversale entre spectateurs. Le CEMEA contrôle, même quand le chorégraphe Rachid Ouramdane regrette l'absence de jugement négatif sur « Les témoins ordinaires ». Qu'importe. Un des animateurs joue le rôle. À d'autres occasions, l'un d'eux formule un avis sur le spectacle et saisit l'opportunité pour énoncer quelques principes chers au CEMEA. Alors que je suis un spectateur plutôt « actif », ils n'ont jamais donné une visibilité à ma démarche. J'avais envisagé que ces débats ouvrent mon blog à des spectateurs. Même si j'ai retranscrit certaines rencontres (Maguy Marin, Wajdi Mouawad, Jan Fabre, Amos Gitaï), cet espace, en reproduisant l'estrade et le parterre, ne m'a pas permis de m'affranchir des barrières hiérarchiques.
ARTE avait elle aussi son lieu à l'Ecole d'Art. Des tables, des ordinateurs, des transats, une télévision et quelques spectateurs allongés ou consultant mails et sites internet. Un cybercafé en somme. Je n'ai fait qu'y passer une tête pour constater le désert et la froideur de l'espace. Paradoxalement, c'est sur Twitter que j'ai pu dialoguer avec les professionnels d'Arte. Comment et avec qui questionner la pertinence de ce lieu ?
Finalement, ces espaces hiérarchisés sont en décalage avec les formes artistiques actuelles. Alors que metteurs en scène et programmateurs encouragent l'émancipation du spectateur, évoquent les traversées (en référence au transversal), les institutions contrôlent l'interaction verticale avec le public. Mais peuvent-elles faire autrement ? Est-ce leur mission de créer l'espace démocratique? Pourquoi ces débats ne sont-ils pas organisés par les spectateurs eux-mêmes, promus par le Festival et financés par des partenaires publics et privés plutôt que cette uniformité qui ne permet plus d'entendre la diversité des points de vue et nous enferme dans le lien « producteur-consommateur » ?
De mon côté, j'ai donc privilégié l'informel pour opérer des rencontres. En arborant un t-shirt siglé « Tadorne www.festivalier.net », j'affichais une identité singulière : spectateur mais différent ! Cette « peau » hybride a incontestablement facilité les liens. À la fin du concert « L'autre rive » de Zad Moultaka à l'Eglise de la Chartreuse, j'ai rencontré Hanane, comédienne. Elle venait à Avignon pour y rechercher du « politiquement réveillé », de « l'humanité », « des chemins de traverse » pour ne pas se cloisonner. Tout mon projet !
D'autres rencontres ont ponctué ce mois théâtral. Elles m'ont permis de créer des relations particulières, à l'articulation du critique et du spectateur. À la fin de certains spectacles, j'ai souvent pris le temps d'écouter en relançant la question, tout en donnant un avis que je remettais en débat (Amos Gitai). Je me suis parfois immiscé dans une conversation de groupe pour provoquer la tension et échapper au consensus mou (Jan Fabre) ; à un autre moment, ce sont de parfaits inconnus qui attendaient le débat à la fin de « Casimir et Caroline » ou des «Inepties volantes » pour se rassurer et ne pas se sentir exclus. Avec « les témoins ordinaires » de Rachid Ouramdane, je n'ai pas hésité à questionner une rangée de jeunes spectateurs ! Ce fut aussi l'occasion de mesurer l'étonnante popularité du blog dans le milieu culturel (notamment chez certains artistes). Quelques spectateurs sont venus spontanément vers moi pour saluer ma démarche « engagée », « libre » (merci à Francis et à tous les autres !). Ce fut aussi l'opportunité de dialoguer autrement avec les professionnels de la culture : le lien s'est avéré plus souple, moins rigide que lors de nos échanges au cours de l'année.
Toutes ces rencontres m'ont permis d'appréhender certains processus du dialogue autour de l'?uvre (en finir avec le « j'aime » ou le « je n'aime pas »). La tâche n
'était pas facile. Qu'en faire aujourd'hui ? Comment poursuivre ce travail que j'avais initié lors du festival « Faits d'Hiver » en 2007 à Paris ?
Trois projets sont en préparation pour cette rentrée. Un avec la Ville d'Aubenas et Isabelle Flumian où en tant que formateur, je vais accompagner un groupe de professionnels du lien social (travailleurs sociaux, animateur de l'éducation, de la petite enfance, de la culture ?) vers la culture afin de créer avec eux les conditions du décloisonnement pour inclure l’art dans leurs pratiques professionnelles.
 Dès septembre, j'intègre l'équipe de consultants de l'entreprise Entrepart animée par Christian et Sylvie Mayeur dont la finalité est de “mêler étroitement l’art dans ses processus de création, l’entrepreneuriat et l’attention aux territoires“. Basée à l'Isle sur Tarn, elle y installe un espace artistique, « La Coursive » (« lieu plastique d'invention à chaleur ajoutée », photo), où j'écrirais régulièrement une chronique.
Dès septembre, j'intègre l'équipe de consultants de l'entreprise Entrepart animée par Christian et Sylvie Mayeur dont la finalité est de “mêler étroitement l’art dans ses processus de création, l’entrepreneuriat et l’attention aux territoires“. Basée à l'Isle sur Tarn, elle y installe un espace artistique, « La Coursive » (« lieu plastique d'invention à chaleur ajoutée », photo), où j'écrirais régulièrement une chronique.
Le troisième projet est avec Annette Breuil, directrice du Théâtre des Salins de Martigues où j'inaugure fin septembre un cycle de débats avec les spectateurs.
Dans ces trois situations, mon positionnement, telle une métaphore, sera questionné: spectateur et professionnel, spectateur et critique, dedans et dehors. C'est dans ce « et » que se nicheront tous nos possibles.
Pascal Bély – www.festivalier.net
Un merci amical à Bernard qui m’a accompagné tout au long du Festival d’Avignon pour me soutenir dans ma créativté, dans mes questionnements et ma fatigue!

 Comment une idée folle, celle de créer un festival de la photographie, naît -elle dans une petite ville comme Arles, que rien ne prédestinait à l'image? On suppose bien des hypothèses : le délire d'un pari, l'amitié, l'histoire, la politique, mais au final, c'est une forte volonté de fous bien pensants et pas des moins connus, de vivre la photo intensément. Cependant, à l'époque, la jeunesse n'ambitionnait pas la force de l'âge. On parlait du moment présent, de rencontre parce que l'on était d'abord entre amis. On évoque Lucien Clergue (photo), Michel Tournier? D'ailleurs au début, et Christian Caujolle (fondateur de l'Agence Vu) l'avoue bien sincèrement, il y avait peu de spectateurs, mais une envie de vivre la passion fougueusement. Et l'aventure a confirmé l'histoire de ces passionnés de l'argentique, puis du numérique, voire de l'informatique et de la vidéo. Aujourd'hui, ceux- là sont nombreux dans les rues d'Arles avec toujours le même désir qu'avant, découvrir et faire découvrir, autrement dit partager, rêver, car c'est bien la fonction première de la photographie. Aux prémices de ces retrouvailles, on dénombrait plus de clichés souvenirs que sur les années les plus récentes. Mais l'âme du départ se veut conserver. On compte 40 ans d'images d'archives, d'ambiance et de contexte de travail, de visages connus, de renommées et d'un temps peu éloigné, mais déjà échappé.
Comment une idée folle, celle de créer un festival de la photographie, naît -elle dans une petite ville comme Arles, que rien ne prédestinait à l'image? On suppose bien des hypothèses : le délire d'un pari, l'amitié, l'histoire, la politique, mais au final, c'est une forte volonté de fous bien pensants et pas des moins connus, de vivre la photo intensément. Cependant, à l'époque, la jeunesse n'ambitionnait pas la force de l'âge. On parlait du moment présent, de rencontre parce que l'on était d'abord entre amis. On évoque Lucien Clergue (photo), Michel Tournier? D'ailleurs au début, et Christian Caujolle (fondateur de l'Agence Vu) l'avoue bien sincèrement, il y avait peu de spectateurs, mais une envie de vivre la passion fougueusement. Et l'aventure a confirmé l'histoire de ces passionnés de l'argentique, puis du numérique, voire de l'informatique et de la vidéo. Aujourd'hui, ceux- là sont nombreux dans les rues d'Arles avec toujours le même désir qu'avant, découvrir et faire découvrir, autrement dit partager, rêver, car c'est bien la fonction première de la photographie. Aux prémices de ces retrouvailles, on dénombrait plus de clichés souvenirs que sur les années les plus récentes. Mais l'âme du départ se veut conserver. On compte 40 ans d'images d'archives, d'ambiance et de contexte de travail, de visages connus, de renommées et d'un temps peu éloigné, mais déjà échappé.

 Martin Parr.
Martin Parr. 
 L'introduction à la ballade faite, on se jette (et c'est bien là le terme) aux ateliers mécaniques ? hall 16- où nous attendent les invités de Nan Goldin. Treize comme une scéne. Un jugement prochain ? On avance inquiet et dubitatif. Et c'est le clash sur l'intime poussé au plus cru de son expression où l'inceste, la naissance, l'errance et la mort se voit exposées. Jean-Christain Bourcart nous le prouve bien en nous attirant malgré nous dans le pays où l'on ne va jamais, sorte de cour des miracles américaine, au c?ur du New Jersey à deux heures de New-York. Et ses photos semblent nous dire : ici mais pas plus loin. On veut se retourner et repartir. Pour où ? Pour là, ce là, si confortable d'où l'on vient. La chaleur de la saison accentue le malaise de la visite. Et pourtant on continue. On erre dans un univers qui ne s'apparente en rien à celui de nos quotidiens rangés et sages. J'étouffe et m'insurge. Cependant, je sais qu'en cela le pari de Nan Goldin est gagné.
L'introduction à la ballade faite, on se jette (et c'est bien là le terme) aux ateliers mécaniques ? hall 16- où nous attendent les invités de Nan Goldin. Treize comme une scéne. Un jugement prochain ? On avance inquiet et dubitatif. Et c'est le clash sur l'intime poussé au plus cru de son expression où l'inceste, la naissance, l'errance et la mort se voit exposées. Jean-Christain Bourcart nous le prouve bien en nous attirant malgré nous dans le pays où l'on ne va jamais, sorte de cour des miracles américaine, au c?ur du New Jersey à deux heures de New-York. Et ses photos semblent nous dire : ici mais pas plus loin. On veut se retourner et repartir. Pour où ? Pour là, ce là, si confortable d'où l'on vient. La chaleur de la saison accentue le malaise de la visite. Et pourtant on continue. On erre dans un univers qui ne s'apparente en rien à celui de nos quotidiens rangés et sages. J'étouffe et m'insurge. Cependant, je sais qu'en cela le pari de Nan Goldin est gagné. A retenir toutefois, le travail de David Armstrong, faisant parti au même titre que Nan Goldin du groupe des cinq de Boston, même si ce dernier ose avouer ne savoir si son travail valait piécette. On retient l'étrange du dandysme dans une sorte de « no man's land » de par son installation où le désordre organisé, ordonne l'atmosphère pour inviter le curieux dans son atelier ainsi transféré. Et le bel acte de la photo romanesque du « beaux gosses » s'étale façon Boston group. On lit l'image dans l'importance de la relation avec le sujet photographié qui ira jusqu'au petit panneau originel de l'entrepôt, en haut de la porte de l'espace d'exposition : Local Banc d'essai.
A retenir toutefois, le travail de David Armstrong, faisant parti au même titre que Nan Goldin du groupe des cinq de Boston, même si ce dernier ose avouer ne savoir si son travail valait piécette. On retient l'étrange du dandysme dans une sorte de « no man's land » de par son installation où le désordre organisé, ordonne l'atmosphère pour inviter le curieux dans son atelier ainsi transféré. Et le bel acte de la photo romanesque du « beaux gosses » s'étale façon Boston group. On lit l'image dans l'importance de la relation avec le sujet photographié qui ira jusqu'au petit panneau originel de l'entrepôt, en haut de la porte de l'espace d'exposition : Local Banc d'essai. Le Festival de Mens dans l'Isère a donc invité « Le Tadorne » pendant une semaine à jouer le rôle du spectateur-critique. Inscrit dans un
Le Festival de Mens dans l'Isère a donc invité « Le Tadorne » pendant une semaine à jouer le rôle du spectateur-critique. Inscrit dans un