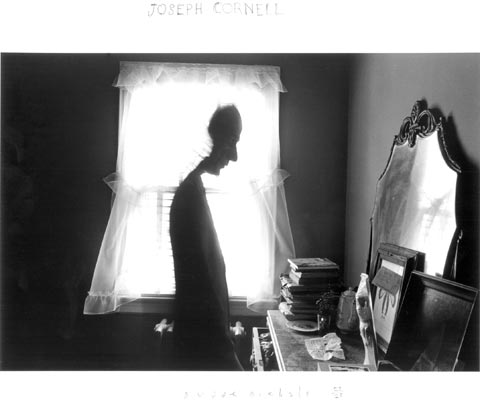L’intérêt des salles non numérotées, c’est qu’on y fait la queue, souvent à l’avance. Ce soir-là, Francis Braun me reconnaît grâce à mon T-shirt siglé « Tadorne ». Il aime mon travail et le fait savoir. Près de lui, Leïla Shahid, déléguée de la Palestine à Bruxelles, aime le festival. Le dialogue s’engage. Nous formons l’agora. C’est aussi cela Avignon !
Depuis, Francis Braun m’écrit. Il m’envoie ses textes d’après spectacles. Ils n’ont pas leur place dans la case «commentaire ». Il est aussi Tadorne, car c’est une parole engagée.
« El final de este estado de cosas, redux » d’Israel Galván.
Merde à la planche qui tape trop fort.
L’accessoire – c’est soit indispensable, soit ça fout tout en l’air.
L’accessoire est parfois essentiel pour une femme. Une robe très simple, presque invisible, elle porte un bijou, un sac ou une écharpe autour du cou….et on ne parle plus de beauté mais de classe et si l’accessoire est bien choisi, alors, on parle d’ALLURE.
Dans un spectacle, c’est parfois le contraire….
L’allure, la classe, c’est le comédien nu, sans accessoire, sans truc, habillé mais nu d’artifice.
C’est lui dans un dé-NU-ment total, pantalon – cheveux gominés, musique, espace et bruit de ses pas.
C’est cet homme ISRAEL GALVAN.
D’abord il est Kazuo No, butoh trapu, ténébreux arquebouté sur lui-même, crispé, bandé, tendu, masqué dans les rochers, dans son carré sablé-éclairé-encadré au sens propre du terme…..pourquoi un masque.
Son corps, ses efforts contenus, son dos voûté, son ventre rentré, ses chevilles en lévitation, sous une force tellurique incroyable….
Oulala, ça va être certainement terrible.
Il danse contre…
Il lutte avec….
Il parle avec ses avant-bras…
Il dit des choses avec sa main qui comme une ombre chinoise qui suggère plus qu’elle ne dit. Il veut quand même nous expliquer, presque nous le crier…
Il insiste, en frappant, en trépignant, en scandant cette violence de son corps qui va comme exploser.
Il est seul maintenant sur ce sable – sur cette transversale sablonneuse……
et soudain ça y est l’accessoire prends le pas sur le danseur.
Merde et pourquoi cette rupture.
On déteste l’anecdote dans ce cas là.
Elle nous distrait, on a du mal à ne voir que lui.
L’accessoire prend à ce moment-là, trop de place. Il ne l’accompagne pas, il se substitue à lui.
Il va danser avec sa planche dans un duo inégal alors qu’un solo égoïste suffirait totalement.
Cette planche subtilement articulée lui répond quand même, comme s’il en était le dompteur….la lutte de deux animaux féroces.
On ne regarde que lui, que cette révolte du Flamenco.
On ne voit que les trépidations d’un homme qui, lorsqu’il danse, veut parler, crier, hurler.
Merde à la planche qui tape trop fort.
À table, il est seul. Et là c’est magnifique.
Il envahit toute la carrière.
Ne parlons pas des musiques rock…
N’écoutons que cet orchestre espagnol, ces mains qui claquent, les pieds qui scandent, ces voix qui hurlent.
L’Union irréelle avec la sauvagerie.
Il ne faut pas qu’il se dissipe, Israel Galvan.
On ne parle pas du film, sûrement pas …. on ne verra que lui, même si le regard se perd parfois.
On cassera même cette bouteille d’
eau qui rend anecdotique sa performance.
On détestera même ce simulacre mort-cercueil et sa lumière dedans.
On évitera le final music-hall qui transforme ce flamenco en produit pour touristes…..
Putain, avec un tel cadre, une telle aura, un tel orchestre, une telle force dans son corps, une telle envie de bousculer, de rentrer dedans…..
Merde la solitude a du bon parfois.
On l’attend ce mammifère trapu dans un prochain dénuement, isolé au son de voix et de lumières flamenco….
Pourquoi n’était-il pas l’épicentre de la Carrière, SEUL avec sa danse sous cette voûte noire et brillante…
On a aimé, mais regretté.
« Un peu de tendresse, bordel de merde ! » de Dave St Pierre.

On se souvient du célèbre “Pina m’a demandé” au Palais des Papes lorsque ses comédiens racontaient des bribes de leur vie intime ….c’était il ya plus de vingt ans, c’était dans le raffinement, le pudique.
Ce soir , aux Célestins , ses « Enfants » se sont fait l’écho de son passé, comme pour mieux la faire renaître…..ils n’ont pas fait pareil, c’était plus “dit”, ils ont montré ce qu’ils savaient faire, ils ont dansé comme des fous, ils ont montré leurs sexes, leurs perruques et leurs fesses, ils ont montré leurs poils, ont joui, ont aimé, ont détesté, dans le calme, la violence et l’orgie, sans scrupules, libérés, outranciers, jamais grossiers…toujours dignes et maîtres d’eux-mêmes.
Ils ont escaladé les gradins, enjambé les spectateurs en deux fois. La première, habillés année 50 avec des vêtements de tous les jours, la seconde fois complètement nus, en prise directe avec nous, joues contre fesses, sexe contre nez, trou du cul contre tête….l’un d’eux a même mis mes lunettes sur sa bite (soyons crus, on emploie les mots qu’il faut…ils vont bien avec ce genre de “show”).
Un show en traduction simultanée, dans un français traduit au premier degré…très rigolo, grinçant et terriblement incisif.
Les Enfants de Pina Bausch, Dave Saint Pierre et sa troupe nous ont raconté…..ils s’en sont tirés à merveille, ils nous ont nous emmener là où l’ont voulait secrètement aller sous les ordres ironiquement sarcastiques d’une Maîtresse Femme, qui a force de menaces et de manipulations, vient s’effondrer à la fin, gracieusement, mais épuisée.
Ce que ceux de Pina ne disaient pas, ses enfants l’ont dit….l’on montré avec joie et violence, se sont bien amusé. Ils ont dansé, ils sont passé sans complaisance du tragique au dérisoire, du rire aux sanglots…..
Merci a eux que l’on aurait aimé serrer dans nos bras, même trempés qu’ils étaient…ils auraient dû saluer parmi nous, dans les gradins……au milieu de nous…..bonjour la suite!!!!!!
« La Menzogna » de Pipo Delbono
Un Italien incarné… ou un Allemand désincarné…. on hésite …..Senior Pipo, Herr Delbono…
Un Opéra Wagnerien…..bien sur, même du Shakespeare Italien….;
Un homme cheveux gominés, lunettes noires…
Roméo costumé, Juliette hurlait.
Moins de Cabaret ce soir – on se souviendra néanmoins du “Travelo – Dalida” dans la cour de la Faculté des Sciences , il y a plus de Tragédie ce soir.
On a tous vu Hamlet de Ostermeier, on n’a pas suivi Apollonia jusqu’au bout….Monsieur Delbono, contrairement à ses contemporains , fait appel à nos pleurs…on est suspendu…larmes peut-être.
Mais Pipo, ce soir, s’est pris pour Jean Vilar lorsqu’à Paris au TNP, il jouait Arturo Ui de Bertold Brecht. Souvenir, clin d’oeil, référence ?
En plein “show”…..un &nbs
p;type derrière nous a crié “c’est bien ficelé”, ….et j’ai répondu “connard”…..
Bien sur qu’il a raison ce type…c’est vrai que c’est super bien fait…la musique, l’opéra, les cris, la douleur, leurs morts…on est pris bien sur par son essoufflement quand il parle, nous chuchote dans le micro ses obsessions lancinantes, on aime son souffle d’émotions, Pipo on t’adore , on te déteste, tu nous fais mal, tu nous fais du bien.
Tu es notre Hiroshima de Alain Resnais, tu parles comme Ennanuella Riva qui se souvient de Nevers-Hiroshima..
Tes ficelles sont impeccables et c’est certain, elle tisse un piège…..on rentre ou on rentre pas.
On t’aime, on te hait….attention tu racontes toujours la même histoire en partant d’un prétexte…mais ce n’est pas grave……on t’aime on te hait quand tu te prends pour Taddéus Kantor, quand tu te fais voyeur, exhibitionniste, photographe ironique , tu vas avoir un sacré album de photos.
Mais bon…..c’est quand même vraiment bien…..souffle coupé comme toi, quelques yeux humides…je peux pleurer ?…On va pas me dire attention sensiblerie et non-dramaturgie…
Et puis vous êtes nus encore, cette année, la guerre, à poil, le gras du bide, les petites couilles…..Tu nous montres tout par ta nudité. Tu as maigri et tu restes devant “nu / nous”…tu jouis de nos regards, Jean Luc aussi est nu….pourquoi encore êtes-vous nus ?….Jean-luc n’est plus l’autiste, il est devenu le Comedien…..tu nous le montres aussi…
Jannot Lucas est devenu comédien grâce à toi, à cause de toi.
Tant mieux , c’est bien….mais merde….. tu l’exhibes un peu trop….Pipo,…..Monsieur Loyal.
Ce ne sont pas des bêtes de foire…maintenant ils existent par eux-mêmes…ils sont autistes , sauvages, SDF…ok maintenant ils actent, ils font l’acteur, ILS SONT COMEDIENS…..grace à toi ok, je te l’accorde.
En toute humilité…bande d’exhibitionnistes que l’on adore…..on est content de te voir amaigri, ayant quitté ta bonhomie pour une classe terrible…..t’as de l’allure en Blues Brother, mec !
Alors, on a pu adorer, on a pu aimer…on a pu détester et critiquer…..
Le principal c’est d’avoir été pris à ta saloperie de piège, on est tombé dans tes filets, on a frémi, on a eu le coeur fêlé…..quand même on ira te revoir…..et puis ta santé est bonne maintenant…ça, c’est bien.
Francis Braun.