Quel bonheur d’avoir croisé le chemin d’Alexandre Castres, lors du Festival « Uzès Danse », avec sa création « Monsieur Zéro, famous when dead » créée dans le non moins select « Festival Temps Image » à La Ferme du Buisson !
Assis sur sa motte de terre, à pleurer son chien enterré, Monsieur Zéro cherche un projet pour nous proposer un spectacle. Il fouille, voit une idée germer, l’attrape et nous la formule : « je vais m’amuser à mourir ». Alliant vidéo-projections et mouvements, Olivier Castres nous emmène sur le terrain de la farce burlesque. Un parfum de Pippo Delbono flotte alors sur la scène…
 Il saisit au bond toutes les facettes de l’absurde en nous comparant aux papillons, êtres éphémères qui peuplent nos jardins. Si notre fin est celle-ci, pourquoi se donner la mort ? En jouant différentes scènes de suicide, Alexandre Castres nous amuse et démontre l’absurdité de vouloir mettre fin à sa vie : « Même si la vie n’est pas drôle tous les jours, n’est-il pas bête de théâtraliser sa mort ? ». S’ôter la vie, même pour participer à un jeu de téléréalité intitulé « Night Shot » avec pour générique « Personal Jesus » des Depeche Mode, chanté en personne par Alexandre Castres, reste incohérent !
Il saisit au bond toutes les facettes de l’absurde en nous comparant aux papillons, êtres éphémères qui peuplent nos jardins. Si notre fin est celle-ci, pourquoi se donner la mort ? En jouant différentes scènes de suicide, Alexandre Castres nous amuse et démontre l’absurdité de vouloir mettre fin à sa vie : « Même si la vie n’est pas drôle tous les jours, n’est-il pas bête de théâtraliser sa mort ? ». S’ôter la vie, même pour participer à un jeu de téléréalité intitulé « Night Shot » avec pour générique « Personal Jesus » des Depeche Mode, chanté en personne par Alexandre Castres, reste incohérent !
C’est alors que résonne la musique du film « Eyes Wide Shut » et nous voilà confrontés à l’image du suicidé par asphyxie. Moment d’une poésie suprême durant lequel l’homme se retrouve face à lui même, égoïste, s’ôtant le dernier souffle de vie en plongeant sa tête dans la terre comme pour s’enterrer et rester maître de son « après ».
Au travers de ses péripéties, Monsieur Zéro nous démontre que trop en faire en se donnant la mort empêche l’être de mourir proprement. Qu’allons-nous laisser alors comme image de notre personne ? Formulation absurde puisque si nous ne sommes plus, nous n’existons plus et notre image finit par s’effacer de la mémoire des connaissances.
Mais quand je n’existe plus, qu’est-ce qu’il advient pour mon être? Rien, le vide, le néant. Mais pourquoi ne plus vouloir être ? L’existence mène à la résistance. Résister à ne pas vouloir penser que l’on va oublier. Vivre.
Teinté de philosophie, le conte qu’Alexandre Castres nous a dévoilé est d’une poésie, d’une justesse absolue et aussi burlesque que notre vie. À travers ses yeux, je vois pointer une féroce envie de vivre et de rire aux éclats.
Alexandre Castres est un artiste en devenir.
À suivre de près, voire de très près.
Laurent Bourbousson – www.festivalier.net
?????? « Monsieur Zéro, famous when dead » d’alexandre Castres a été joué le 18 juin 2008 dans le cadre du Festival Uzès Danse.
| Revenir au sommaire | Consulter la rubrique danse du site. |





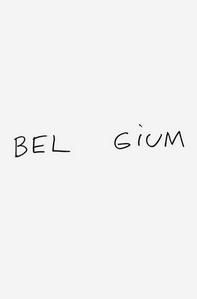

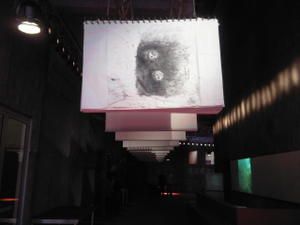
 “Dying as a country” de Michael Marmarinos est la super production du KunstenFestivalDesArts de Bruxelles. Cent cinquante figurants à la fois sur scène, de l’entrée à la sortie d’une grande salle, au c?ur d’une friche industrielle : voilà pour le décorum. La taille du plateau du Palais des Papes d’Avignon n’est rien à côté de cet espace mégalomaniaque et complètement inadapté au théâtre. Pour se rendre sur les gradins, le public double une longue file de figurants. Une fois assis et en attendant que tout le monde prenne place, nous subissons la logorrhée verbale d’une jeune comédienne prisonnière d’un petit carré dessiné sur scène. Un spectateur, excédé, hurle en quittant les lieux : « mais tu ne vas pas la fermer ! ». Ce cri de rage annonce le calvaire qui va suivre.
“Dying as a country” de Michael Marmarinos est la super production du KunstenFestivalDesArts de Bruxelles. Cent cinquante figurants à la fois sur scène, de l’entrée à la sortie d’une grande salle, au c?ur d’une friche industrielle : voilà pour le décorum. La taille du plateau du Palais des Papes d’Avignon n’est rien à côté de cet espace mégalomaniaque et complètement inadapté au théâtre. Pour se rendre sur les gradins, le public double une longue file de figurants. Une fois assis et en attendant que tout le monde prenne place, nous subissons la logorrhée verbale d’une jeune comédienne prisonnière d’un petit carré dessiné sur scène. Un spectateur, excédé, hurle en quittant les lieux : « mais tu ne vas pas la fermer ! ». Ce cri de rage annonce le calvaire qui va suivre. Nos quatre acteurs vont tout oser pour décrire avec violence, tendresse, renoncement, avancement, la « fin » de tant d’histoires qu’elles finissent par nous étourdir. Nous sourions de nous entendre, de nous voir, lors de ruptures amoureuses, de conflits familiaux, où finalement nous passons le plus clair de notre temps à penser la fin comme un éternel recommencement. Ces quatre acteurs sont prodigieux dans leur engagement à ne jamais lâcher, même quand le pont ne mène nulle part, même lorsqu’on s’enferme dans un schéma répétitif, ou se cacher dans un placard est le seul refuge pour se protéger du regard de l’autre. Beatriz Catani donne à chaque interprète une profondeur psychologique étonnante, où le corps se débat en même temps que la blatte lutte contre la mort (les séances de masturbation collective ne sont pas qu’intellectuelles…). Ce n’est jamais caricatural parce que profondément humain. On est étonné de leur énergie à passer d’une histoire à l’autre sans que la mise en scène en souffre, comme s’il fallait ne rien perdre de ce temps suspendu où la blatte n’est pas encore morte. C’est dans cet interstice qu’ils repensent leur vie comme un long poème, quelquefois drôle, le plus souvent surréaliste. L’atmosphère est celle d’un rêve éveillé, d’un cauchemar où les personnages de notre existence se donnent rendez-vous pour revisiter nos névroses et régler quelques comptes ! Le plateau transpire comme lorsque nous luttons en pleine nuit. Nous pourrions tous nous incarner dans chacun d’eux, dans leur quête absolu de vouloir recommencer, de rechercher le sens là où il n’y ait pas a priori. On ne peut toutefois s’empêcher de ressentir une Argentine qui souffre mais espère des jours meilleurs en puisant dans sa créativité les ressorts du renouveau.
Nos quatre acteurs vont tout oser pour décrire avec violence, tendresse, renoncement, avancement, la « fin » de tant d’histoires qu’elles finissent par nous étourdir. Nous sourions de nous entendre, de nous voir, lors de ruptures amoureuses, de conflits familiaux, où finalement nous passons le plus clair de notre temps à penser la fin comme un éternel recommencement. Ces quatre acteurs sont prodigieux dans leur engagement à ne jamais lâcher, même quand le pont ne mène nulle part, même lorsqu’on s’enferme dans un schéma répétitif, ou se cacher dans un placard est le seul refuge pour se protéger du regard de l’autre. Beatriz Catani donne à chaque interprète une profondeur psychologique étonnante, où le corps se débat en même temps que la blatte lutte contre la mort (les séances de masturbation collective ne sont pas qu’intellectuelles…). Ce n’est jamais caricatural parce que profondément humain. On est étonné de leur énergie à passer d’une histoire à l’autre sans que la mise en scène en souffre, comme s’il fallait ne rien perdre de ce temps suspendu où la blatte n’est pas encore morte. C’est dans cet interstice qu’ils repensent leur vie comme un long poème, quelquefois drôle, le plus souvent surréaliste. L’atmosphère est celle d’un rêve éveillé, d’un cauchemar où les personnages de notre existence se donnent rendez-vous pour revisiter nos névroses et régler quelques comptes ! Le plateau transpire comme lorsque nous luttons en pleine nuit. Nous pourrions tous nous incarner dans chacun d’eux, dans leur quête absolu de vouloir recommencer, de rechercher le sens là où il n’y ait pas a priori. On ne peut toutefois s’empêcher de ressentir une Argentine qui souffre mais espère des jours meilleurs en puisant dans sa créativité les ressorts du renouveau. Habillée en maîtresse d’école ou en manager de chez l’Oréal (car elle le vaut bien !), Rebekah Rousi stupéfie son auditoire avec sa logorrhée verbale où les mots, les lettres du PowerPoint sont disséquées dans une rationalité poussée à l’extrême. Elle étire chaque phrase, chaque expression jusqu’à devoir entrer et sortir de la salle. Sa voix, prête à se briser, s’amplifie pour créer un contexte où l’absurdité devient une mélodie, une partition, un manifeste. Son cerveau fonctionne à plein régime, comme quand Google recherche des occurrences.
Habillée en maîtresse d’école ou en manager de chez l’Oréal (car elle le vaut bien !), Rebekah Rousi stupéfie son auditoire avec sa logorrhée verbale où les mots, les lettres du PowerPoint sont disséquées dans une rationalité poussée à l’extrême. Elle étire chaque phrase, chaque expression jusqu’à devoir entrer et sortir de la salle. Sa voix, prête à se briser, s’amplifie pour créer un contexte où l’absurdité devient une mélodie, une partition, un manifeste. Son cerveau fonctionne à plein régime, comme quand Google recherche des occurrences. Rebekah Rousi décompose les mots pour recomposer une image, un mouvement, une sensation qui crée ces nouvelles voies pour apprendre et écouter la complexité. Avec force et empathie, elle nous guide vers le déconditionnement linguistique pour introduire d’autres constructions propices à penser à partir du sens. Avec obstination et talent, elle offre aux spectateurs, le cours qu’il leur manquait pour comprendre le langage artistique de ce KunstenFestivalDesArts décidément si postmoderne !
Rebekah Rousi décompose les mots pour recomposer une image, un mouvement, une sensation qui crée ces nouvelles voies pour apprendre et écouter la complexité. Avec force et empathie, elle nous guide vers le déconditionnement linguistique pour introduire d’autres constructions propices à penser à partir du sens. Avec obstination et talent, elle offre aux spectateurs, le cours qu’il leur manquait pour comprendre le langage artistique de ce KunstenFestivalDesArts décidément si postmoderne ! Le décor pose d’emblée l’espace relationnel des acteurs et la surface de divagation du spectateur. La scène, pas plus grande qu’une chambre d’enfant, est la salle d’un restaurant familial japonais, un « famire » : il n’émerge du plateau que la partie haute des chaises et des tables. Six comédiens, aux corps contraints et aux histoires personnelles corsetées, vont habiter cet espace réduit, comme après une inondation ou un tremblement de terre. Ce décor d’une subtilité incroyable reflète le désir d’Okada d’articuler la société japonaise, où la liberté se mesure en nombre de minutes, avec la structure familiale.
Le décor pose d’emblée l’espace relationnel des acteurs et la surface de divagation du spectateur. La scène, pas plus grande qu’une chambre d’enfant, est la salle d’un restaurant familial japonais, un « famire » : il n’émerge du plateau que la partie haute des chaises et des tables. Six comédiens, aux corps contraints et aux histoires personnelles corsetées, vont habiter cet espace réduit, comme après une inondation ou un tremblement de terre. Ce décor d’une subtilité incroyable reflète le désir d’Okada d’articuler la société japonaise, où la liberté se mesure en nombre de minutes, avec la structure familiale. Une cliente arrive ; elle s’accorde ses trente minutes quotidiennes avec pour compte à rebours, un rond qu’elle dessine à l’infini sur son carnet à spirales. À l’issue du temps réglementaire, la feuille est un trou noir dans lequel mon regard plonge, quasiment paralysé par le jeu de ces acteurs. Clients et propriétaires du lieu s’immiscent dans l’imaginaire de cette femme pour goûter à cette liberté si chèrement gagnée sur une société industrielle japonaise qui standardise l’imagination et les modes de pensée. À mesure que « Freetime » avance, les histoires s’entrechoquent et « dessinent» un territoire où le spectateur erre d’un acteur à l’autre, se perd, retrouve le fil et s’intègre dans les nouveaux liens sociaux désirés par Okada.. Ces « trente minutes » remettent en dynamique ce que la société a figé et la mise en scène épouse ce long processus.
Une cliente arrive ; elle s’accorde ses trente minutes quotidiennes avec pour compte à rebours, un rond qu’elle dessine à l’infini sur son carnet à spirales. À l’issue du temps réglementaire, la feuille est un trou noir dans lequel mon regard plonge, quasiment paralysé par le jeu de ces acteurs. Clients et propriétaires du lieu s’immiscent dans l’imaginaire de cette femme pour goûter à cette liberté si chèrement gagnée sur une société industrielle japonaise qui standardise l’imagination et les modes de pensée. À mesure que « Freetime » avance, les histoires s’entrechoquent et « dessinent» un territoire où le spectateur erre d’un acteur à l’autre, se perd, retrouve le fil et s’intègre dans les nouveaux liens sociaux désirés par Okada.. Ces « trente minutes » remettent en dynamique ce que la société a figé et la mise en scène épouse ce long processus. Pour masquer la faiblesse du texte et du scénario, Robert Lepage ne lésine pas sur l’esthétique. Comme dans un
Pour masquer la faiblesse du texte et du scénario, Robert Lepage ne lésine pas sur l’esthétique. Comme dans un