Au Théâtre du Gyptis de Marseille, ce n’est pas la foule des grands jours pour le spectacle de Nacera Belaza, « Le pur hasard » qui clôture la 9e édition du festival Dansem. On pourrait s’interroger sur ce choix de programmation très pointu qui éloigne un peu plus le public habitué des festivals de l’été.
Il faut avoir le goût du risque pour s’aventurer sur le terrain de cette chorégraphe. Lors du dernier Festival Montpellier Danse, sa création «Un an après », m’avait laissé perplexe. Et pourtant, je suis là ce soir avec le désir de rencontrer de nouveau Nacera Belaza, conscient que cette artiste atypique a quelque chose à nous dire…
Vingt minutes de retard.
 C’est lent, très lent. Je n’abandonne pas. Je fixe cette silhouette qui s’avance vers nous. Je m’obstine à vouloir comprendre son propos alors qu’elle tourne autour de cette chaise en ouvrant et fermant ses bras. Je m’accroche pour saisir le lien avec l’écran vidéo où un homme cherche à sortir d’un enfermement. Je suis prêt à m’abandonner. D’autres images m’envahissent : « demain, ah oui, demain…faudra pas se rater…journée importante »… « En sortant, ne pas oublier… ». Je pars, c’est plus fort que tout. Une minute peut-être. Le noir. Le blanc.
C’est lent, très lent. Je n’abandonne pas. Je fixe cette silhouette qui s’avance vers nous. Je m’obstine à vouloir comprendre son propos alors qu’elle tourne autour de cette chaise en ouvrant et fermant ses bras. Je m’accroche pour saisir le lien avec l’écran vidéo où un homme cherche à sortir d’un enfermement. Je suis prêt à m’abandonner. D’autres images m’envahissent : « demain, ah oui, demain…faudra pas se rater…journée importante »… « En sortant, ne pas oublier… ». Je pars, c’est plus fort que tout. Une minute peut-être. Le noir. Le blanc.
Je reviens. Ce n’est plus la même. Une autre femme apparaît. Et toujours ces mêmes gestes de rondeur et de précision. L’éclairage tamisé de la scène hypnotise, une douce musique orientale berce…Ils sont trois : deux femmes et lui, en vidéo. Ils se cherchent.
J’abandonne. Le noir. Je pars, loin, trop loin… « Tout à l’heure, en partant, ne pas oublier » …
Je reviens. Elles sont là. Où suis-je ? Entre rêve et réalité, mon corps ne sait plus très bien comment se tenir. Je souffre de me sentir à l’extérieur de ce langage. C’est fermé, presque enfermant. Elles cherchent. Quoi ? Qui ? Pour quoi ? Rien n’y fait. Cette danse-là n’est pas pour moi. J’abandonne.
Soudain, « My way » en fond musical. Elles s’approchent en venant vers nous, l’une à côté de l’autre. Elles sont de dos.
Surgit alors une image fulgurante.
Dix secondes.
Sublime.
« En partant, ne pas oublier… »
Pour réagir, cliquez sur "ajouter un commentaire". Une fenêtre s’ouvre alors. Tapez votre texte puis recopiez les trois lettres qui vous sont proposées dans la petite case. A bientôt de vous lire.
Pour revenir à la page d’accueil, cliquez ici.



 Elle nous regarde, prend une carabine, prête à la diriger vers nous. D’un mouvement gracieux, elle pointe son engin vers le plafond et tire. Une statuette religieuse tombe à terre. Ouf, nous sommes sauvés. Sofia Asensio, danseuse venue de Barcelone, peut commencer à « étudier les mystères de la sainteté » à partir d’un personnage ignorant, qu’elle incarne, « c’est-à-dire quelqu’un qui croit encore aux mystères ».
Elle nous regarde, prend une carabine, prête à la diriger vers nous. D’un mouvement gracieux, elle pointe son engin vers le plafond et tire. Une statuette religieuse tombe à terre. Ouf, nous sommes sauvés. Sofia Asensio, danseuse venue de Barcelone, peut commencer à « étudier les mystères de la sainteté » à partir d’un personnage ignorant, qu’elle incarne, « c’est-à-dire quelqu’un qui croit encore aux mystères ». En arrivant, je ressens comme un décalage entre les dorures de ce théâtre à l’italienne et le jazz, entre ce public un peu « guindé » et l’énergie communicative de la musique de Manu Katché. Assis, je suis coincé entre deux aimables cadres cravatés et une barre en fer qui me coupe la vision de la scène. Je reste à l’étroit tout au long du concert comme s’il était impossible de s’affranchir de ce cadre.
En arrivant, je ressens comme un décalage entre les dorures de ce théâtre à l’italienne et le jazz, entre ce public un peu « guindé » et l’énergie communicative de la musique de Manu Katché. Assis, je suis coincé entre deux aimables cadres cravatés et une barre en fer qui me coupe la vision de la scène. Je reste à l’étroit tout au long du concert comme s’il était impossible de s’affranchir de ce cadre. Il y a des soirées où Le Tadorne doit s’accrocher à son siège pour ne pas voler dans les plumes. Certains « chorégraphes » ont semblent-ils pris le parti de se faire plaisir au détriment de l’art qu’ils sont censés servir. « La surface de divagation » de Montaine Chevalier et d’Elodie Moirenc présentée dans le cadre du festival « Dansem » à Marseille est de ces oeuvres que je préfère enterrer au plus vite. Cinquante-cinq minutes de divagation artistique qui auraient pu être un beau spectacle si ses concepteurs n’en avaient oublié le sens. Pourtant, le premier tableau est de toute beauté : un homme joue de la guitare, une femme accroche des lambeaux de plastique sur fond de lumière bleue (hommage sincère à «
Il y a des soirées où Le Tadorne doit s’accrocher à son siège pour ne pas voler dans les plumes. Certains « chorégraphes » ont semblent-ils pris le parti de se faire plaisir au détriment de l’art qu’ils sont censés servir. « La surface de divagation » de Montaine Chevalier et d’Elodie Moirenc présentée dans le cadre du festival « Dansem » à Marseille est de ces oeuvres que je préfère enterrer au plus vite. Cinquante-cinq minutes de divagation artistique qui auraient pu être un beau spectacle si ses concepteurs n’en avaient oublié le sens. Pourtant, le premier tableau est de toute beauté : un homme joue de la guitare, une femme accroche des lambeaux de plastique sur fond de lumière bleue (hommage sincère à « 
 La deuxième proposition, « Toy Toy » de Sabine de Viviès, jouée à 22 heures, nous replonge dans une œuvre très conceptuelle. Elle a le mérite de défricher de nouveaux territoires autour des articulations entre la danse et la vidéo comme une métaphore du « dedans – dehors ». Je suis convié au coeur d’un voyage intérieur, comme une immersion dans un univers féminin, non violent, très doux. Je ressens de l’apaisement à regarder ces deux femmes se chercher l’une et l’autre. C’est une création qui explore les possibles, ouvre quand tout est fermé, projette, élève quand l’attention est clouée au sol. C’est la danse d’un regard qui s’ouvre de soi vers l’autre, du vertical à l’horizontal. J’aime ce moment de création : j’y décéle l’obstination de ces femmes à nous proposer cette ouverture de la relation.
La deuxième proposition, « Toy Toy » de Sabine de Viviès, jouée à 22 heures, nous replonge dans une œuvre très conceptuelle. Elle a le mérite de défricher de nouveaux territoires autour des articulations entre la danse et la vidéo comme une métaphore du « dedans – dehors ». Je suis convié au coeur d’un voyage intérieur, comme une immersion dans un univers féminin, non violent, très doux. Je ressens de l’apaisement à regarder ces deux femmes se chercher l’une et l’autre. C’est une création qui explore les possibles, ouvre quand tout est fermé, projette, élève quand l’attention est clouée au sol. C’est la danse d’un regard qui s’ouvre de soi vers l’autre, du vertical à l’horizontal. J’aime ce moment de création : j’y décéle l’obstination de ces femmes à nous proposer cette ouverture de la relation. 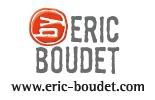
 Pourtant, le contexte est tragique. Nous sommes en 1805 et Napoléon dirige d'une main de fer presque toute l'Europe sauf la Russie, qui résiste. Sur scène, une carte ? rideau de l'Europe s'ouvre et se ferme au rythme des trois actes. De chaque côté, deux portraits inachevés de Napoléon et d'Alexandre 1er accrochés à deux piliers. Ils soutiennent un décor d'un étage fait d'armatures en fer où échelles et cadres en bois pivotants font office d'escaliers et de portes. Ce décor dit tout : entre la France et la Russie, une famille se déchire à coup d'héritage, de trahisons bonapartistes et de fidélité à la mère patrie. Entre le contexte international et la complexité des liens familiaux, Piotr Fomenko réussit à animer cette carte au gré des alliances et coalitions des acteurs. Le mobilier en bois donne à l'ensemble un aspect vivant et fragile ; le jeu balance entre insouciance et gravité à l'image de l'encadrement des portes avec lequel les comédiens s'amusent pour entrer et s'en libérer. Lorsqu'ils marchent en apesanteur sur des chaises ou des marches d'escalier, la mise en scène joue sur l'équilibre des forces entre français et Russes, entre la mort et la vie.
Pourtant, le contexte est tragique. Nous sommes en 1805 et Napoléon dirige d'une main de fer presque toute l'Europe sauf la Russie, qui résiste. Sur scène, une carte ? rideau de l'Europe s'ouvre et se ferme au rythme des trois actes. De chaque côté, deux portraits inachevés de Napoléon et d'Alexandre 1er accrochés à deux piliers. Ils soutiennent un décor d'un étage fait d'armatures en fer où échelles et cadres en bois pivotants font office d'escaliers et de portes. Ce décor dit tout : entre la France et la Russie, une famille se déchire à coup d'héritage, de trahisons bonapartistes et de fidélité à la mère patrie. Entre le contexte international et la complexité des liens familiaux, Piotr Fomenko réussit à animer cette carte au gré des alliances et coalitions des acteurs. Le mobilier en bois donne à l'ensemble un aspect vivant et fragile ; le jeu balance entre insouciance et gravité à l'image de l'encadrement des portes avec lequel les comédiens s'amusent pour entrer et s'en libérer. Lorsqu'ils marchent en apesanteur sur des chaises ou des marches d'escalier, la mise en scène joue sur l'équilibre des forces entre français et Russes, entre la mort et la vie.  Je pourrais recenser à l'infini les subtilités de cette mise en scène de l'équilibre : quand le rez-de-chaussée joue, le premier étage éclaire sur l'enjeu ; les mots en français sont disséminés dans le texte comme autant de notes de musiques qui allègent le jeu. Le plaisir de jouer des comédiens devient le plaisir d'être spectateur comme si le lien de l'époque entre la France et la Russie se créait dans la salle. Troublant?
Je pourrais recenser à l'infini les subtilités de cette mise en scène de l'équilibre : quand le rez-de-chaussée joue, le premier étage éclaire sur l'enjeu ; les mots en français sont disséminés dans le texte comme autant de notes de musiques qui allègent le jeu. Le plaisir de jouer des comédiens devient le plaisir d'être spectateur comme si le lien de l'époque entre la France et la Russie se créait dans la salle. Troublant? Sur scène, un petit théâtre avec de jolis rideaux rouges, posé sur des tréteaux, celui-là même qui nous faisait rêver enfant lorsqu’on s’interrogeait sur l’origine des ficelles des marionnettes ! Une jeune fille en sort, perruquée en blonde platine, manteau en peau de bête. Elle se déhanche maladroitement pour nous guider dans ce monde imaginaire. Le conte peut bien commencer, je m’écroule dans le fauteuil. Le début semble laborieux : ces personnages mi — homme, mi — bête rampent à partir d’une chorégraphie qui hésite entre langages prétentieux ou ridicules. Il faut attendre le deuxième tableau pour réveiller ma fatigue ! Le conte trouve enfin le ton juste : la métamorphose sert alors de fil conducteur, le corps est au centre d’un propos tendre et amusant. Ces cinq personnages créent leur univers burlesque avec des objets que rien ne relie a priori (une échelle, des guirlandes de roses électriques, un parapluie vert). Par magie, les danseurs jouent les métamorphoses que nous orchestrions enfant, quand nous élaborions dans des endroits incroyables des cachettes transformées en petite maison !
Sur scène, un petit théâtre avec de jolis rideaux rouges, posé sur des tréteaux, celui-là même qui nous faisait rêver enfant lorsqu’on s’interrogeait sur l’origine des ficelles des marionnettes ! Une jeune fille en sort, perruquée en blonde platine, manteau en peau de bête. Elle se déhanche maladroitement pour nous guider dans ce monde imaginaire. Le conte peut bien commencer, je m’écroule dans le fauteuil. Le début semble laborieux : ces personnages mi — homme, mi — bête rampent à partir d’une chorégraphie qui hésite entre langages prétentieux ou ridicules. Il faut attendre le deuxième tableau pour réveiller ma fatigue ! Le conte trouve enfin le ton juste : la métamorphose sert alors de fil conducteur, le corps est au centre d’un propos tendre et amusant. Ces cinq personnages créent leur univers burlesque avec des objets que rien ne relie a priori (une échelle, des guirlandes de roses électriques, un parapluie vert). Par magie, les danseurs jouent les métamorphoses que nous orchestrions enfant, quand nous élaborions dans des endroits incroyables des cachettes transformées en petite maison !  Mais le conte bute sur des choix de mise en scène contestables: le burlesque, omniprésent, laisse peu de place à la fragilité (une jeune adolescente apeurée se fait voler la vedette par un homme gros qui se jette à corps perdu sur des matelas). En multipliant les tableaux tel un boulimique entrant dans une pâtisserie, Giogio Rossi perd le langage chorégraphique. En a-t-il conscience lorsqu’il nous offre à la fin des applaudissements un « bonus » dansé hésitant? Décidement, à vouloir trop en faire, Giogio Rossi s’épuise à montrer les limites de son art et finit par grossir tous les traits.
Mais le conte bute sur des choix de mise en scène contestables: le burlesque, omniprésent, laisse peu de place à la fragilité (une jeune adolescente apeurée se fait voler la vedette par un homme gros qui se jette à corps perdu sur des matelas). En multipliant les tableaux tel un boulimique entrant dans une pâtisserie, Giogio Rossi perd le langage chorégraphique. En a-t-il conscience lorsqu’il nous offre à la fin des applaudissements un « bonus » dansé hésitant? Décidement, à vouloir trop en faire, Giogio Rossi s’épuise à montrer les limites de son art et finit par grossir tous les traits.