Chaque mois d’octobre à Marseille se déroule un festival pour le moins atypique. «Dansem» diffuse des créations au croisement de la danse et de la performance du bassin méditérannéen dans des lieux parfois improbables. Ce soir, le nom de code du rendez-vous («Les bancs publics») sonne comme une invitation alléchante! J’ignore cette salle et pour cause. Nichée au cœur du quartier de la Belle de Mai, elle est une scène d’expérimentations culturelles. Ce festival se positionne donc clairement sur la recherche artistique ; comme le souligne un spectateur fumant sa cigarette sur le trottoir : «c’est sûr, ici, ce n’est pas le Zénith».  La première pièce, «Poussée» du chorégraphe tunisien Nejib Ben Khalfallah surprend par sa sincérité dans un milieu (la danse) peu enclin à nous montrer l’envers du décor. Deux musiciens, un danseur (en kilt, un Ipod à la taille et un masque sur le visage !) et Nejib Ben Khalfallah lui-même sont réunis au cours d’un processus de création en proie aux doutes du chorégraphe. A terre, un sac de voyage vidé progressivement de ses fragiles matériaux (magnétophone, photo, bouteille d’alcool,…). Nous sommes bien en Tunisie, pays riche sur les dépliants touristiques, mais pauvre en moyens alloués à la danse. Sur scène, ce milieu masculin (quoique très ambiguë!) se fragilise dès que les tâtonnements du chorégraphe émergent. À la danse quelque peu «stéréotypée » et provocante du danseur, répond la recherche du chorégraphe dont les mouvements empruntent des chemins chaotiques émouvants, mais jamais brouillons. L’écoute de l’enregistrement d’une conférence « occidentale » sur la danse perd le créateur, mais lui donne la force de s’affranchir des concepts fumeux et foireux. Le chorégraphe semble bien plus libre que son danseur, à moins que cela ne soit l’inverse ! Ce danseur en kilt est-il l’inconscient du chorégraphe ? Metaphorise-t-il le désir d’émancipation du Maghreb? C’est au spectateur de dénouer les fils d’un processus qui s’éloigne d’une linéarité enfermante : qui domine qui, qui s’émancipe de qui et de quoi ? Cette création rend possible tous les angles de vue comme si Nejib Ben Khalfallah cherchait toujours, loin des certitudes. Ces messages paradoxaux, voir confus, servent de fil rouge et confèrent à cette «Poussée» de bien jolies naissances créatives comme en témoigne la dernière scène où la transe solitaire du chorégraphe émeut jusqu’aux frissons.
La première pièce, «Poussée» du chorégraphe tunisien Nejib Ben Khalfallah surprend par sa sincérité dans un milieu (la danse) peu enclin à nous montrer l’envers du décor. Deux musiciens, un danseur (en kilt, un Ipod à la taille et un masque sur le visage !) et Nejib Ben Khalfallah lui-même sont réunis au cours d’un processus de création en proie aux doutes du chorégraphe. A terre, un sac de voyage vidé progressivement de ses fragiles matériaux (magnétophone, photo, bouteille d’alcool,…). Nous sommes bien en Tunisie, pays riche sur les dépliants touristiques, mais pauvre en moyens alloués à la danse. Sur scène, ce milieu masculin (quoique très ambiguë!) se fragilise dès que les tâtonnements du chorégraphe émergent. À la danse quelque peu «stéréotypée » et provocante du danseur, répond la recherche du chorégraphe dont les mouvements empruntent des chemins chaotiques émouvants, mais jamais brouillons. L’écoute de l’enregistrement d’une conférence « occidentale » sur la danse perd le créateur, mais lui donne la force de s’affranchir des concepts fumeux et foireux. Le chorégraphe semble bien plus libre que son danseur, à moins que cela ne soit l’inverse ! Ce danseur en kilt est-il l’inconscient du chorégraphe ? Metaphorise-t-il le désir d’émancipation du Maghreb? C’est au spectateur de dénouer les fils d’un processus qui s’éloigne d’une linéarité enfermante : qui domine qui, qui s’émancipe de qui et de quoi ? Cette création rend possible tous les angles de vue comme si Nejib Ben Khalfallah cherchait toujours, loin des certitudes. Ces messages paradoxaux, voir confus, servent de fil rouge et confèrent à cette «Poussée» de bien jolies naissances créatives comme en témoigne la dernière scène où la transe solitaire du chorégraphe émeut jusqu’aux frissons. La deuxième proposition, « Toy Toy » de Sabine de Viviès, jouée à 22 heures, nous replonge dans une œuvre très conceptuelle. Elle a le mérite de défricher de nouveaux territoires autour des articulations entre la danse et la vidéo comme une métaphore du « dedans – dehors ». Je suis convié au coeur d’un voyage intérieur, comme une immersion dans un univers féminin, non violent, très doux. Je ressens de l’apaisement à regarder ces deux femmes se chercher l’une et l’autre. C’est une création qui explore les possibles, ouvre quand tout est fermé, projette, élève quand l’attention est clouée au sol. C’est la danse d’un regard qui s’ouvre de soi vers l’autre, du vertical à l’horizontal. J’aime ce moment de création : j’y décéle l’obstination de ces femmes à nous proposer cette ouverture de la relation.
La deuxième proposition, « Toy Toy » de Sabine de Viviès, jouée à 22 heures, nous replonge dans une œuvre très conceptuelle. Elle a le mérite de défricher de nouveaux territoires autour des articulations entre la danse et la vidéo comme une métaphore du « dedans – dehors ». Je suis convié au coeur d’un voyage intérieur, comme une immersion dans un univers féminin, non violent, très doux. Je ressens de l’apaisement à regarder ces deux femmes se chercher l’une et l’autre. C’est une création qui explore les possibles, ouvre quand tout est fermé, projette, élève quand l’attention est clouée au sol. C’est la danse d’un regard qui s’ouvre de soi vers l’autre, du vertical à l’horizontal. J’aime ce moment de création : j’y décéle l’obstination de ces femmes à nous proposer cette ouverture de la relation.
Pour une soirée, l’avenir de la création est passé par Tunis et Marseille. « En se fouettant pas mal du regard oblique », ces bancs publics avaient ce soir des petites gueules bien sympathiques.
Pour réagir, cliquez ci-dessous sur "ajouter un commentaire". Une fenêtre s’ouvre alors. Tapez votre texte puis recopiez les trois lettres qui vous sont proposées dans la petite case. A bientôt de vous lire.
Pour revenir à la page d’accueil, cliquez ici.

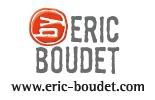
 Pourtant, le contexte est tragique. Nous sommes en 1805 et Napoléon dirige d'une main de fer presque toute l'Europe sauf la Russie, qui résiste. Sur scène, une carte ? rideau de l'Europe s'ouvre et se ferme au rythme des trois actes. De chaque côté, deux portraits inachevés de Napoléon et d'Alexandre 1er accrochés à deux piliers. Ils soutiennent un décor d'un étage fait d'armatures en fer où échelles et cadres en bois pivotants font office d'escaliers et de portes. Ce décor dit tout : entre la France et la Russie, une famille se déchire à coup d'héritage, de trahisons bonapartistes et de fidélité à la mère patrie. Entre le contexte international et la complexité des liens familiaux, Piotr Fomenko réussit à animer cette carte au gré des alliances et coalitions des acteurs. Le mobilier en bois donne à l'ensemble un aspect vivant et fragile ; le jeu balance entre insouciance et gravité à l'image de l'encadrement des portes avec lequel les comédiens s'amusent pour entrer et s'en libérer. Lorsqu'ils marchent en apesanteur sur des chaises ou des marches d'escalier, la mise en scène joue sur l'équilibre des forces entre français et Russes, entre la mort et la vie.
Pourtant, le contexte est tragique. Nous sommes en 1805 et Napoléon dirige d'une main de fer presque toute l'Europe sauf la Russie, qui résiste. Sur scène, une carte ? rideau de l'Europe s'ouvre et se ferme au rythme des trois actes. De chaque côté, deux portraits inachevés de Napoléon et d'Alexandre 1er accrochés à deux piliers. Ils soutiennent un décor d'un étage fait d'armatures en fer où échelles et cadres en bois pivotants font office d'escaliers et de portes. Ce décor dit tout : entre la France et la Russie, une famille se déchire à coup d'héritage, de trahisons bonapartistes et de fidélité à la mère patrie. Entre le contexte international et la complexité des liens familiaux, Piotr Fomenko réussit à animer cette carte au gré des alliances et coalitions des acteurs. Le mobilier en bois donne à l'ensemble un aspect vivant et fragile ; le jeu balance entre insouciance et gravité à l'image de l'encadrement des portes avec lequel les comédiens s'amusent pour entrer et s'en libérer. Lorsqu'ils marchent en apesanteur sur des chaises ou des marches d'escalier, la mise en scène joue sur l'équilibre des forces entre français et Russes, entre la mort et la vie.  Je pourrais recenser à l'infini les subtilités de cette mise en scène de l'équilibre : quand le rez-de-chaussée joue, le premier étage éclaire sur l'enjeu ; les mots en français sont disséminés dans le texte comme autant de notes de musiques qui allègent le jeu. Le plaisir de jouer des comédiens devient le plaisir d'être spectateur comme si le lien de l'époque entre la France et la Russie se créait dans la salle. Troublant?
Je pourrais recenser à l'infini les subtilités de cette mise en scène de l'équilibre : quand le rez-de-chaussée joue, le premier étage éclaire sur l'enjeu ; les mots en français sont disséminés dans le texte comme autant de notes de musiques qui allègent le jeu. Le plaisir de jouer des comédiens devient le plaisir d'être spectateur comme si le lien de l'époque entre la France et la Russie se créait dans la salle. Troublant? Sur scène, un petit théâtre avec de jolis rideaux rouges, posé sur des tréteaux, celui-là même qui nous faisait rêver enfant lorsqu’on s’interrogeait sur l’origine des ficelles des marionnettes ! Une jeune fille en sort, perruquée en blonde platine, manteau en peau de bête. Elle se déhanche maladroitement pour nous guider dans ce monde imaginaire. Le conte peut bien commencer, je m’écroule dans le fauteuil. Le début semble laborieux : ces personnages mi — homme, mi — bête rampent à partir d’une chorégraphie qui hésite entre langages prétentieux ou ridicules. Il faut attendre le deuxième tableau pour réveiller ma fatigue ! Le conte trouve enfin le ton juste : la métamorphose sert alors de fil conducteur, le corps est au centre d’un propos tendre et amusant. Ces cinq personnages créent leur univers burlesque avec des objets que rien ne relie a priori (une échelle, des guirlandes de roses électriques, un parapluie vert). Par magie, les danseurs jouent les métamorphoses que nous orchestrions enfant, quand nous élaborions dans des endroits incroyables des cachettes transformées en petite maison !
Sur scène, un petit théâtre avec de jolis rideaux rouges, posé sur des tréteaux, celui-là même qui nous faisait rêver enfant lorsqu’on s’interrogeait sur l’origine des ficelles des marionnettes ! Une jeune fille en sort, perruquée en blonde platine, manteau en peau de bête. Elle se déhanche maladroitement pour nous guider dans ce monde imaginaire. Le conte peut bien commencer, je m’écroule dans le fauteuil. Le début semble laborieux : ces personnages mi — homme, mi — bête rampent à partir d’une chorégraphie qui hésite entre langages prétentieux ou ridicules. Il faut attendre le deuxième tableau pour réveiller ma fatigue ! Le conte trouve enfin le ton juste : la métamorphose sert alors de fil conducteur, le corps est au centre d’un propos tendre et amusant. Ces cinq personnages créent leur univers burlesque avec des objets que rien ne relie a priori (une échelle, des guirlandes de roses électriques, un parapluie vert). Par magie, les danseurs jouent les métamorphoses que nous orchestrions enfant, quand nous élaborions dans des endroits incroyables des cachettes transformées en petite maison !  Mais le conte bute sur des choix de mise en scène contestables: le burlesque, omniprésent, laisse peu de place à la fragilité (une jeune adolescente apeurée se fait voler la vedette par un homme gros qui se jette à corps perdu sur des matelas). En multipliant les tableaux tel un boulimique entrant dans une pâtisserie, Giogio Rossi perd le langage chorégraphique. En a-t-il conscience lorsqu’il nous offre à la fin des applaudissements un « bonus » dansé hésitant? Décidement, à vouloir trop en faire, Giogio Rossi s’épuise à montrer les limites de son art et finit par grossir tous les traits.
Mais le conte bute sur des choix de mise en scène contestables: le burlesque, omniprésent, laisse peu de place à la fragilité (une jeune adolescente apeurée se fait voler la vedette par un homme gros qui se jette à corps perdu sur des matelas). En multipliant les tableaux tel un boulimique entrant dans une pâtisserie, Giogio Rossi perd le langage chorégraphique. En a-t-il conscience lorsqu’il nous offre à la fin des applaudissements un « bonus » dansé hésitant? Décidement, à vouloir trop en faire, Giogio Rossi s’épuise à montrer les limites de son art et finit par grossir tous les traits. “
“
 Justement, il arrive. À terre, de multiples pédales. Il est petit, presque frêle, et profondément touchant à nous proposer sa musique qu’il bidouille avec ses pieds tout en jouant de la guitare ! À peine chante-t-il que j’entends
Justement, il arrive. À terre, de multiples pédales. Il est petit, presque frêle, et profondément touchant à nous proposer sa musique qu’il bidouille avec ses pieds tout en jouant de la guitare ! À peine chante-t-il que j’entends  Il est une heure du matin. Les mots se bousculent, les notes s’entrechoquent dans ma tête. C’est un joli chaos. La fête des Correspondances de Manosque vient de se dérouler au Café Provisoire en compagnie de musiciens et d’écrivains. J’ai reçu de l’énergie, de l’espoir alors que la France dans le monde semble se replier, maltraitée par le caniche de Bush qui n’hésite pas à pisser sur l’intelligence. D’entendre ces artistes lire leurs contributions pour « réveiller le monde » (thème proposé par les Correspondances) a quelque chose de réjouissant tel un acte de résistance créatif. Dix écrivains montent sur scène accompagnés de chansons de la «bande» à
Il est une heure du matin. Les mots se bousculent, les notes s’entrechoquent dans ma tête. C’est un joli chaos. La fête des Correspondances de Manosque vient de se dérouler au Café Provisoire en compagnie de musiciens et d’écrivains. J’ai reçu de l’énergie, de l’espoir alors que la France dans le monde semble se replier, maltraitée par le caniche de Bush qui n’hésite pas à pisser sur l’intelligence. D’entendre ces artistes lire leurs contributions pour « réveiller le monde » (thème proposé par les Correspondances) a quelque chose de réjouissant tel un acte de résistance créatif. Dix écrivains montent sur scène accompagnés de chansons de la «bande» à  Dans la région, c’est
Dans la région, c’est  La salle du Théâtre Jean le Bleu de Manosque est comble ce soir. En voisine, Ariane Ascaride s’empare des lettres d’Ilo de Franceschi écrites à Madeleine Allain entre 1939 – 1940. Passionné de littérature, cet italien d’origine (parlant l’allemand, le français et un dialecte Kanak !) s’engage dans la Légion où près de la chaîne de l’Atlas dans le Maroc, il ressent l’isolement par l’absence de livres. Il prend l’initiative d’écrire au philosophe Alain pour qu’il lui envoie trois ouvrages. Par erreur, cette lettre atterrit chez Madeleine Allain. Commence alors une histoire d’amitié, presque amoureuse.
La salle du Théâtre Jean le Bleu de Manosque est comble ce soir. En voisine, Ariane Ascaride s’empare des lettres d’Ilo de Franceschi écrites à Madeleine Allain entre 1939 – 1940. Passionné de littérature, cet italien d’origine (parlant l’allemand, le français et un dialecte Kanak !) s’engage dans la Légion où près de la chaîne de l’Atlas dans le Maroc, il ressent l’isolement par l’absence de livres. Il prend l’initiative d’écrire au philosophe Alain pour qu’il lui envoie trois ouvrages. Par erreur, cette lettre atterrit chez Madeleine Allain. Commence alors une histoire d’amitié, presque amoureuse.